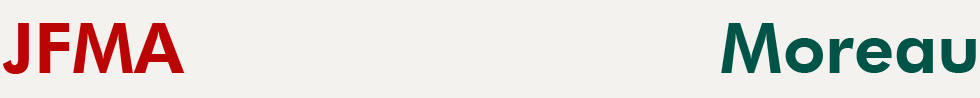Le fichier va se charger dans quelques instants
Si le fichier ne se charge pas, cliquez sur ce lien
![]() 265 Ko
265 Ko
JF MOREAU pour L'Internat de Paris - écrit le 10 juillet 2006 (draft) Page 1 21/01/2020
Un radiologue du XXe siècle : de la bombe A à l'IRM via le scanographe d'Hounsfield.
Jean-François Moreau
Né le 27 avril 1938, l'enfant avait atteint l'âge de raison lorsque les bombes atomiques du Projet Manhattan de l'Oncle Sam détruisirent Hiroshima et de Nagasaki le 6 août 1945. Le monde se mettait à l'abri de nouvelles guerres mondiales ouvertes, relayées toutefois par la guerre froide entre les Alliés de la veille devenus ennemis idéologiques. Le garçonnet rêva longtemps de son premier vrai « bikini », ce slip de bain sulfureux baptisé du nom de l'atoll où eut lieu l'explosion atomique expérimentale de 1946, porté par le nageur olympique prestigieux Alex Jany[1] bien avant Brigitte Bardot. C'était une pièce de tissu en forme de sablier qui dégageait le nombril, moulait les creux et les bosses et tenait sur le pelvifessier grâce aux deux lacets latéraux noués comme sur des dos de chaussures de tennis. Il était trop jeune en 1945 pour s'intéresser à la création du Commissariat à l'Energie Atomique par le Prix Nobel communiste Frédéric Joliot puis à l'appel antinucléaire de Stockholm de 1950 qu'il présida[2]. Jusqu'à l'adduction d'eau courante municipale en 1960, l'eau minérale de Plancoët, Source Sassay, la plus radioactive de France, lisait-on sur l'étiquette, était l'unique alternative à l'eau du puit vectrice, elle, de la fièvre typhoïde. De ce fait, l'adolescent acnéique resta serein lors de l'explosion de la première bombe H américaine en 1952. Au contraire, réagirent par la panique les copains du film « Avant le Déluge », meurtriers absurdes d'un Roger Coggio, nouvel Alain Gerbault pacifiste rêvant d'une Polynésie idyllique; il se contenta de le revoir trois fois de suite dans la même semaine, tombé amoureux éperdu qu'il fut de la splendide Marina Vlady, âgée de quatorze ans comme lui[3] et à qui André Cayatte venait de donner là son premier rôle. Il s'éveilla à la politique sous Pierre Mendès-France qui lança le programme nucléaire militaire français en 1954 que reprit Charles de Gaulle en 1958. il approuva les explosions des bombes A dans le Sahara.
En 1965, à 27 ans, le jeune adulte, fraîchement marié et nommé au concours de l'internat, sortit médecin-aspirant de l'école des officiers de réserve de Libourne pour aller se morfondre au CIT 151 de Montlhéry. Il se retrouva heureusement vite muté au Département des Applications Militaires du CEA. Dans le Centre d'Essais de Limeil-Brévannes, on calculait la force de frappe sur des ordinateurs américains surpuissants, mais il n'y avait aucun risque de contamination radioactive pour le personnel. Les ingénieurs, dont le sang était contrôlé comme tout le personnel tous les trois mois, étaient volontiers leucopéniques avec neutropénie ; l'hématologue de référence Jean Bernard, consulté à plusieurs reprises à l'hôpital Saint-Louis, attribua ces anomalies à une tendance psychosomatique courante chez les intellectuels de l'X et de Normale Sup', et les médecins du travail cessèrent de s'en émouvoir. À trois reprises et au titre de l'OTAN, le médecin devenu sous-lieutenant fut envoyé en mission de plusieurs semaines sur la base militaire d'Inamguel, dans le Hoggar, où eurent lieu les explosions atomiques expérimentales dans une montagne dont il fit le tour en 2CV. Il en revint fan du désert. À son dernier retour et par curiosité, il passa une spectrogammamétrie du corps humain dans une sorte de sarcophage. Il avait deux pics isotopiques radioactifs, l'un de K40, comme tous les humains depuis la création du monde, et d'un autre[4]apparu, lui, avec les explosions atomiques terrestres type Colomb-Béchar. Tous les Européens avaient les mêmes gammamétries. Pourquoi s'en formaliser ?
Le jeune interne devait choisir une orientation de carrière. Pour devenir médecin interniste, Fred Siguier, le mentor de l'époque, conseillait de savoir lire parfaitement les examens radiologiques sinon les faire soi-même comme les Allemands. La discipline radiologique n'était pas officiellement enseignée dans le cursus des études de médecine, sauf en gastro-entérologie et en pneumo-phtisiologie. Il choisit un poste au plus près de chez lui et se trouva interne chez Guy Ledoux-Lebard, à l'hôpital Cochin. Le radiothérapeute Alain Laugier s'était fait l'évangéliste de la promotion de la radiologie moderne par la voie de l'internat des hôpitaux de Paris[5]. Les perspectives de carrières hospitalo-universitaires paraissaient aussi ouvertes que celle de l'exercice libéral. Dans l'un comme dans l'autre cas, on ne risquait pas de mourir de faim ; l'aspiration à devenir riche était réputée être la motivation principale des jeunes radiodiagnosticiens. Par contre, vivre en compagnie des radiations ionisantes toute leur vie rebutait nombre de collègues. Lors d'un deuxième semestre chez Jean-René Michel, le chef de service de la Salpêtrière, sa vocation se heurta à un problème de numération globulaire inattendu : une anémie à 3 000 000 d'hématies par millimètre cube de sang. Le matériel de radiologie était très vétuste - l'un datait d'avant la guerre ! Les irradiations directes et diffusées étaient considérables au cours des demi-journées d'examens spéciaux digestifs, une bonne douzaine avec un temps élevé de radioscopie dans l'obscurité. La dosimétrie obligatoire était peu fiable. L'hématologue de l'hôpital Beaujon, Jacques Mallarmé, mit fortement en doute l'intérêt de poursuivre l'idée d'une carrière radiologique, mais la numération refaite dans son laboratoire s'avéra normale. Les collègues médecins de la salle de garde de la Salpêtrière connaissaient l'anémie à 3 000 000 d'hématies quand les frottis sanguins passaient sous les yeux d'une certaine laborantine. Les examens hématologiques se faisaient encore artisanalement à la cellule de Malassez ; il y avait une forte opérateur-dépendance en biologie comme en radiologie.
Mai 68 révolutionna en bien le cursus hospitalo-universitaire de l'électroradiologie. En naquirent une radiologie puis une imagerie moderne de plus en plus professionnelle. Jacques Lefebvre et Maurice Tubiana amorcèrent la séparation de l'enseignement et de la pratique du radiodiagnostic et de la radiothérapie[6], branche à laquelle l'interne ne s'intéressa définitivement pas. Ils introduisirent l'obligation de traiter du risque des radiations ionisantes dans un programme formel de radiologie des carabins. L'interne qui cumulait les fonctions d'attaché-assistant de radiologie à Paris 5-Necker l'enseigna pendant sept ans. Il décida d'opter définitivement pour le radiodiagnostic, une fois achevée sa formation d'interniste en 1971. Il ne fut pas et ne sera jamais séduit par l'exercice de la médecine nucléaire, celle qui utilise les isotopes radioactifs à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Elle fut détachée de la radiologie dès sa création après la Libération et dirigée depuis Orsay. Sa pratique était strictement confinée au service public, principalement dans les Centres anticancéreux. L'Assistance Publique à Paris n'avait pas poussé à son développement dans ses hôpitaux.
Marié avec une excellente infirmière pédiatrique[7], Michèle née Lucas, l'interne aurait vécu parfaitement heureux si le couple ne s'était révélé infertile sinon stérile depuis neuf ans déjà. Avait-il eu tort de ne pas suivre Mallarmé dans son aversion pour la radiologie ? Le spermogramme était normal, mais les insufflations tubaires post-coïtales répétées sur l'épouse étaient toujours inefficaces, malgré l'indiscutable compétence du praticien. Fallait-il donner de l'importance à la surirradiation subie par la jeune infirmière pionnière de la néonatologie de Saint-Vincent de Paul pendant les cinq années passées chez Marcel Lelong et Daniel Alagille ? Elle tint suspendus, par les mains et à bout de bras, les nourrissons examinés derrière les appareils de radioscopies des services de néonatologie comme de radiopédiatrie, pendant des temps incalculablement longs. Elle se trouva donc dans les conditions quasi expérimentales qui permirent à Antoine Béclère de décrire la radiologie clinique mais aussi de se nécroser la main droite. Elle ne portait pas de dosimètre ni de tablier plombé. C'était il y a cinquante ans. Le gynécologue-obstétricien enthousiaste et obstiné autant que rude, Michel Chartier pour ne pas le nommer, avait assuré au mari « Cette femme aura un enfant ! Je le garantis ! Je ne sais pas quand ! Je ne sais pas avec qui !!! Oh pardon, mon vieux ! Ce n'était pas ce que je voulais dire ! » On commençait à évoquer l'adoption sinon le divorce. L'enfant du hasard fut conçu au début du printemps 1971. L'échographie fœtale n'existait pas, la mère était presque quarantenaire, l'enfant serait-il bien formé ? Il fallut attendre neuf mois et l'accouchement le 24 décembre pour recevoir l'heureux produit de la conception d'un enfant normal sur tous les plans.
Il était alors chef de clinique à Necker, dans le tout nouveau Palais du Rein. Entre Jean Hamburger à l'Est et Roger Couvelaire à l'Ouest, Jean-René Michel avait fait de son service la référence française en radiologie urinaire. On y faisait une cinquantaine d'UIV par jour, des urétro-cystographies retrogrades par vingtaines, des artériographies rénales par demi-douzaines. Comment ne pas se pencher sur le problème quotidien de l'irradiation des testicules et des ovaires des malades durant ces examens, surtout les femmes et les enfants ? Et regrettablement parfois aussi des fœtus ignorés de la mère ou cachés au radiologue qui se révélaient sur les clichés sans préparation de l'abdomen. Il n'y avait que deux parades à l'angoisse métaphysique qui fit fuir tant de radiologues devant cette dualité de responsabilités dissuasives : user des rayons X et des produits de contraste iodés réputés dangereux pour produire des examens d'interprétation préjugée très difficile[8]. Elles sont et seront éternellement valables en médecine hippocratique. La première consiste à récuser toute indication inutile à la procédure diagnostique d'un symptôme et/ou d'une maladie. La seconde est de réaliser un examen dans son intégralité potentielle tout en usant d'une technique aussi économique en agents vulnérants que possible. On ne nuit pas à son malade en décidant d'y aller si on ne peut pas faire autrement mieux que d'y aller. Mais on lui nuirait à coup sûr si, une fois que l'on a décidé d'y aller, on n'allait pas jusqu'au bout de ce que la technique offre pour justifier les espoirs mis en elle, c'est-à-dire une aide réelle au diagnostic. Un examen normal a alors autant d'intérêt médical qu'un résultat pathologique, n'en déplaise à certains technocrates. Nommé professeur et chef de service hospitalo-universitaire, il continua d'enseigner et de pratiquer cette exigence conforme à la meilleure éthique, sans jamais se faire désavouer, ni en France ni à l'étranger, jusqu'à ce jour de septembre 2006 où il prit sa retraite pour devenir journaliste.
Dans les années 1970, apparurent deux nouveaux concepts qui bouleversèrent la pratique médicale, notamment celle du radiodiagnostic. L'école harvardienne de Barbara McNeil[9][10]exporta l'idée de coût-efficacité des moyens diagnostiques et thérapeutiques pour réguler les budgets des dépenses de santé. L'un des effets pervers fut un risque de bâclage d'examens d'imagerie pour cause de technologies trop dépendantes du prix de l'énergie, du support, de la nomenclature ou de la maintenance. Le concept de méthode invasive dite de vulnérance vient de ce souci de se soustraire des dangers des sources nuisibles, au premier rang desquels se situent toujours aujourd'hui les radiations ionisantes et les produits de contraste. Les ondes ultrasonores ne sont pas ionisantes. Les pionniers propagandistes de l'échographie ultrasonore usèrent trop de l'idée selon laquelle l'imagerie radiologique est vulnérante contrairement à la leur qui serait totalement inoffensive. Le professeur de radiologie se lança dans l'ultrasonographie médicale en 1978 et se forma chez Thérèse Planiol et Léandre Pourcelot, eux-mêmes professeurs de biophysique à l'Université de Tours[11]. L'opérateur-dépendance du diagnostic ultrasonographique était telle à l'époque - elle l'est toujours, mais les échographes modernes en temps réel avec triplex doppler voire reconstruction tridimensionnelle rendent les pièges d'origine technique plus faciles à éviter - qu'il se refusa à substituer l'échographie urinaire à l'UIV qu'il exigea pendant longtemps avant de prendre le transducteur[12].
Dans cette même décennie 70, apparut le CT scanner - académiquement le scanographe - qui vaudra à Geoffrey Hounsfield un Prix Nobel et une baronnie. S'il était compréhensible que les purs ultrasonographistes y voient toujours un nouveau produit des rayons X, nombre de radiologues le sacrèrent non-vulnérant parce qu'ils les libéraient, pensaient-ils, des produits de contraste iodés voire de la prise de trop nombreux clichés. Ils n'eurent raison qu'à court terme car, très vite, les examens scanographiques exigèrent des quantités croissantes d'iode, souvent très supérieures à celles que requière une UIV maximaliste de type Necker. De plus, les séries de coupes de plus en plus nombreuses et plus fines se multiplièrent durant une même séance[13]. La révolution technologique apporta la résonance magnétique nucléaire peu de temps après. Fut-ce cet adjectif inquiétant qui gêna ? La RMN fit rapidement place à l'IRM. Technologie lourde aussi bien en contraintes architecturales qu'en euros, l'imagerie RM était jusqu'à ces dernières semaines considérée comme non-vulnérante. Une directive de la Commission de Bruxelles d'origine anglo-saxonne remet en cause cette certitude. En ira-t'il ainsi avec le Positron-Emission-Tomography (PET-scanner), agressif pour le moment seulement pour les finances des budgétivores ?
En 1986, Maurice Tubiana et lui présidaient aux destinées chaotiques du XVIè Congrès International de Radiologie de Paris (ICR'89).Il fallait ramener la radiologie nord-américaine dans le sein de l'International Society of Radiology (ISR) qu'elle avait quitté après le désastreux ICR'85 d'Honolulu. Quelques semaines après l'explosion du réacteur de Tchernobyl, il se rendit à Baltimore pour que l'American College of Radiology fasse un come-back avec les honneurs de la guerre. L'ISR contribuait au budget de deux commissions de l'Agence internationale de l'énergie atomique (IAAE) de Vienne, Autriche. L'une, l'ICRP chargée de la radioprotection, allait jouer un rôle trop important pour que les USA négligent de participer aux débats sur le risque nucléaire induit par cette catastrophe après celle de Three Mile Island. L'autre, l'ICRU, s'occupait de la réforme des unités de radiations et de leurs mesures. Il obtint gain de cause et la possibilité d'inclure un symposium dédié à Tchernobyl dans le programme scientifique de la section radiodiagnostic le 6 juillet 1989. Maurice Tubiana et lui voulaient que ce rendez-vous fondamental pour l'avenir du risque radique ait lieu pour témoigner de leur volonté de ne pas fuir la discussion objective des effets secondaires réels des explosions nucléaires accidentelles. Il y fut notamment évoqué le rôle qu'allait jouer l'échographie dans l'enquête épidémiologique des nodules thyroïdiens[14] chez les rescapés et dans les régions traversées par le nuage radioactif. Il inscrivit de nouveau ce problème dans le programme du Symposium Thyroïde-Parathyroïdes'92, tenu à l'hôpital Necker. L'endocrinologue pédiatre de l'hôpital Trousseau, Marie-Charles Raux-Eurin, qui conduisait une action de suivi des enfants irradiés en Ukraine, y participa à cette fin.
Une certitude existe et pour longtemps : la technologie croît en potentiels plus vite que les capacités humaines à s'adapter aux effets qu'elles provoquent sur l'exercice des professions de santé. Toutes les défenses naturelles ou artificielles que l'humain édifie pour contrôler le phénomène sont faillibles à plus ou moins court terme. L'ultrasonographie, classée non-vulnérante tant qu'elle reste à usage purement diagnostique, devient potentiellement vulnérante quand elle est utilisée de façon aberrante pour équiper les lunaparks en fœto-DVD-cinématographes. Toutes les techniques d'imagerie peuvent se transformer d'outils purement diagnostiques en moyens thérapeutiques nécessairement beaucoup plus agressifs. Viennent s'introduire dans le débat de la définition de la vulnérance de nouveaux interlocuteurs : les législateurs, les juristes, les banquiers, les assureurs, les philosophes..., pour ne citer que ceux qui tentent de mieux canaliser positivement la nécessité de protéger les citoyens de l'infirmité iatrogénique. Les spécialistes de la radioprotection[15]s'associent à ceux qui assument le risque nucléaire[16] en général pour réclamer une rationalisation du devoir de précaution, notion maintenant constitutionnelle dans le droit français, mais nullement absente dans les autres pays de l'Union Européenne.
Le professeur, devenu honoraire, de retour du congrès mondial d'ultrasonographie médicale tenu à Séoul au début de juin 2006, conjecture sur un avenir médical livré de plus en plus à l'imagerie organo-fonctionnelle par ultrasons. Pour son gourou américain, Barry B Goldberg, du Thomas Jefferson University Hospital de Philadelphie, l'échographie représente déjà 25 pour cent des examens d'imagerie diagnostique pratiqués au quotidien dans le monde entier. Ceci signifie que presque tous les autres sont effectués avec des rayonnements ionisants ou des champs magnétiques. Scanographes et IRM aujourd'hui équipent des plateaux d'imagerie lourds. Ils seront de plus en plus concentrés dans des mégacentres dont la Mayo Clinic est un des exemples les plus achevés. Comment ne pas imaginer que, dans quelques décennies, un immeuble collectif, un pâté de maison, un dispensaire de quartier - et pourquoi pas un appartement ou une villa ? - ne soient pas équipés de scanographes et d'IRM compacts de la taille d'un congélateur ou d'une machine à laver ? L'instrument épouserait vos formes pour obtenir des images d'un organe à l'origine de symptômes d'une maladie à diagnostiquer et à traiter sur place, au meilleur coût-efficacité, éventuellement par un robot ?
En Corée, les populations de tous âges sont en pointe dans l'adoption des techniques de communications informatiques les plus évoluées vers la miniaturisation et l'Internet à haut débit. Les échographes miniaturisés, dits portatifs, sont donc appelés à se généraliser dans les cabinets médicaux certes, mais surtout chez l'habitant lui-même, télémédecine oblige. Le professeur se voit, dans moins de dix ans, avec son échographe multifonctions compacté de style iPod, porté sur lui puis déposé sur sa table de nuit. Avec quelle énergie ces outils fonctionneront-ils ? Richard L Garwin[17], le grand expert atomiste américain compagnon de Georges Charpak, doute fortement que ce soit avec des nanocentrales nucléaires incluses dans le corps de l'appareil lui-même[18]. Le professeur est déçu par cette réticence émise par un savant infiniment plus crédible que lui. Mais il reste persuadé que la télémédecine[19] [20] ne va pas tarder à exiger la constance et l'inépuisabilité du courant électrique qui alimente tous les moyens de communication à distance exigé par la sédentarisation à domicile des personnes ayant le devoir de rester spirituelles durant le XXIe siècle qui commence. Quel que soit le futur du nucléaire, de la terratonne de TNT au picojoule produits, l'être humain doit mûrir suffisamment pour comprendre que son sort est lié à la domestication des radiations ionisantes à des fins civiles utiles, nécessaires et/ou indispensables pour faire fonctionner aussi bien de mégapoles hospitalières que des sonotones dans les oreilles des sourds qui voudraient bien entendre comme vous et encore moi.
Page 6/6 21/01/2020
[1]http://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_Jany
[2]http://fr.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Joliot-Curie
[3] Elle est Gémeaux, lui Taureau.
[4] Le cesium137 (cf. H Morin, C Prieur. Pierre Pellerin serein sur son nuage. Le Monde, 30 juin 2006. pp20-21)
[5] JF Moreau. Et l'Internat conquit la radiologie. L'Internat de Paris, 1998, n° 16, 25-27.
[6] La réforme de l'internat qualifiant autonomisa la radiothérapie qui devint comme dans la mouvance américaine « oncologie thépeutique» (radiation oncology).
[7] La photographie de Michèle Lucas soignant un nouveau-né illustre la page de titre intérieure du Traité de Pédiatrie de R. Debré et M. Lelong.
[8] JF Moreau, J Affre. Les clefs de l'interprétation : l'urographie intraveineuse. Flammarion Médical Sciences, Paris, 1980.
6BJ McNeil, SJ Adelstein et al. Primer on certain elements of medical decision making. Measures of clinical efficacy. 1. Cost-effectiveness calculations in the diagnosis and treatment. 2. The value of case finding in hypertensive renovascular disease. N Engl J Med. 1975 Jul31;293(5):211-226
[10] BJ McNeil . A summary of cost-effectiveness calculations in the diagnosis and treatment of hypertensive renovascular disease. Bull N Y Acad Med. 1976 Jul-Aug;52(6):680-689.
[11] JF Moreau. La naissance de l'échographie à l'hôpital Necker et ce qui s'ensuivit. J.E.M.U., 1990, 11, n°4, 241-247.
[12] JF Moreau. UIV vs échographie ou UIV ± échographie UIV vs échographie ou UIV ± échographie ? J Urol, 1981, 87, 217-218.
[13] L'actuel scanographe à 64 barrettes fabrique en un temps record des myriades de coupes jointives ultrafines que l'informatique transforme par reconstruction 3D en blocs anatomiques parfaits et un manipulables qui raviraient Léonard de Vinci reconverti dans la réalité virtuelle. L'homo radiologicus est né pour le grand bonheur des nouveaux surréalistes, des hyperréalistes et des cinéastes « gore » de la cinquième dimension.
[14] JF Moreau, L Carlier-Conrads.Imagerie Diagnostique des Glandes Thyroïde et Parathyroïdes. Vigot, Paris, 1984, 265 pages.
[15] M Tubiana. Radiologie et radioprotection. PUF, Que Sais-Je, n°2439, 2002.
[16] G Charpak, RL Garwin, V Journé. De Tchernobyl en tchernobyls.Odile Jacob, Paris, 2005.
[17] http://www.fas.org/RLG/
[18] RL Garwin . Communication personnelle (courriels du 28 juin 2006).
[19] JF Moreau et al. Medical imaging in geriatrics : state-of-the-art and prospective. Longévité et Qualité de Vie, une révolution mondiale. 3ème Congrès International organisé par le Conseil International pour un progrès global de la santé, Paris, Unesco, 1998, p. 90.
[20]JF Moreau, J Chabriais, H le Guern, C Balleyguier. Telemedicine : medicine + telecommunications. In "Advanced infrastructures for future healthcare" edited by A Marsh, L Grandinetti, T Kauranne, Ios Pr Inc, 2001