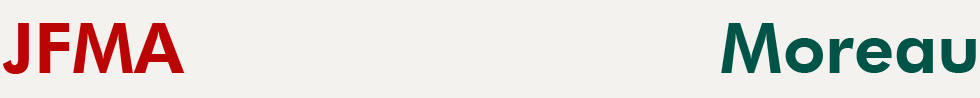5.5.2. SAN FRANCISCO, MARS 1981
Jean Lautrou n'avait pas apprécié l'exiguïté de la place qu'Elliott Lasser avait dévolue à la France dans le symposium de Colorado Springs. Il s'était entendu avec le futur Président du CERF, Michel Amiel, pour l'organisation à Lyon d'un grand colloque européen plus ouvert. Il me demanda de le seconder dans une entreprise qui imposait que les Américains viennent voir sur place ce que nous valions. Cette idée me plaisait. Je fis un court voyage à Lyon pour voir comment on pouvait s'entendre sur une liste d'invités d'outre-Atlantique.
Fort opportunément, je devais reprendre l'avion pour San Francisco en mars, afin d'assister au congrès de l'American Rœntgen Ray Society. J'y retrouvai Bruce Hillman et JeanClaude Gaux qui allait succéder à Jean Ecoiffier à Broussais et chauffait également dur pour obtenir le DIVA. Nous passerons une joyeuse soirée chez l'excellent jazzman Chuck Murphy, dans un coin perdu et franchement sinistre de l'Embarcadero où ne manquaient que Starsky et Hutch pour coincer Charles Bronson, Clint Eastwood, Jill Ireland et Sondra Locke. Ce saloon datait des années 25 et fut détruit en même temps que tout le quartier, quelques mois après notre visite, faisant disparaître l'un des plus beaux témoins de la lutte de la société libertaire contre le puritanisme. John Amberg gagna la coupe de golf de l'ARRS, qu'il guignait depuis plus d'un an.
J'emmenai Glen Hartman et Robert Hattery dîner chez Scott's. Ils me firent part de leur travail en cours sur les accidents des produits de contraste survenus à la Mayo Clinic avec des séries comparables à celles de Jean-René Michel. « Quelle est la position de Necker ? » questionna Glen dans le courant de la conversation, qui n'avait pas mis longtemps à comprendre la stature que prenait maintenant l'uroradiologie française, avec Necker et les vedettes du « Club du Rein ». Seuls la Mayo Clinic et Necker pouvaient alors exhiber une statistique monobloc de même taille, portant sur plus de cent mille UIV ! Nous avions les mêmes ratios d'accidents et d'incidents. Il n'y avait eu aucun cas de décès dans la série de Necker.
5.11. SYMPOSIUM PRODUITS DE CONTRASTE RADIOLOGIQUE, LYON, SEPTEMBRE 1981
Le colloque de Lyon fut un très grand succès. J'emmenai les Benness dans ma voiture ; sa femme Pamela ne vécut pas pendant les cinq heures du voyage, tant l'effrayèrent la vitesse des camions et la fragilité de la French Chrysler roulant à cent trente à l'heure sur l'autoroute du Sud. Les travaux français étaient excellents. Les Européens étaient venus nombreux et les Américains reçurent ce jour-là une leçon d'humilité. L'innovation était de notre côté de l'Atlantique et il fallait harmoniser nos relations A la fin du colloque, Amiel et moi proposâmes aux principaux leaders anglophones d'organiser des symposia biennaux alternativement en Europe et en Amérique. Le premier se tiendrait à San Francisco et deux ans plus tard je serais le prochain chairman européen. Geoffrey Benness fut pour beaucoup dans l'adhésion d'Elliott Lasser à cette idée. Je ramenai les Lasser et Brasch à Paris, après avoir fait une halte dans un grand restaurant de Mâconnais. L'euphorie baignait et même Phyllis Lasser perdait de sa morgue et commençait à voir la France sous un autre œil beaucoup moins malveillant. «Don't take you too much seriously», me taquinait-elle maintenant.
Sur l'esplanade du Trocadéro, Elliott prononça cette phrase que je me remémorerai souvent trop tard avant l'action « You should waiste a little bit of time ». Cet homme svelte, mince et sans âge, originaire de Pittsburgh, parlait lentement et clairement comme la plupart des grands professeurs de l'Est, mais il parsemait ses phrases de mots qui me réjouissaient l'âme. Gotta, wanna, gonna, dunno, aint... se trouvaient dans nombre des titres des morceaux de jazz et des chansons que j'avais en disque. Je ne les avais pas appris à l'école et pour cause, ce sont des expressions argotiques en principe prohibées dans le langage académique américain. « I'm gonna goin' to do somethin' good for you» « What I wanna say is not what I gonna do... » « Do you wanna sit close ? ». La France évoluait vers une meilleure approche des touristes, de plus en plus nombreux avec le dollar reaganien et le yen redevenus les devises étalon, cependant que le franc plongeait. Je prenais goût à ce travail d'agence de voyage et mon appartement devenait une halte appréciée où au moins un repas familial de Parisien les attendait. La grande majorité de mes visiteurs étrangers n'avaient jamais pénétré dans un intérieur familial français. Mon fils apprit à participer à cet accueil privilégié.
6.5. SAN FRANCISCO, AUTOMNE 1983
Je me rendis compte de cette nouvelle vulnérabilité en septembre 1983 en reprenant le chemin des USA. À San Francisco, régnait alors une vague de chaleur supérieure à cent degrés Fahrenheit plus de 40°C avec hausse historique des records. La réunion de la Society of Uroradiology à laquelle je participais fut un échec. Le chairman l'avait programmée en plein Rosh-ah-Shana qui retint chez eux la forte cohorte juive de la société. L'uroradiologie américaine traversait alors une crise encore plus sévère qu'en France. Les départements de radiologie étaient traditionnellement organisés dans une structure de sous-spécialités par organes. On était radiologue cardio-vasculaire, osseux, neurologique, gastro-intestinal... L'arrivée des nouvelles technologies imposait une nouvelle génération de radiologues spécialisés par appareillage. Les ultrasonographistes, les scanographistes, les tous nouveaux pionniers de la résonance magnétique nucléaire s'occupaient de tous les organes sans trop se préoccuper de leurs rattachements à tel ou tel système organique, neuroradiologie mise à part. La radiologie conventionnelle urinaire, déjà peu reluisante aux USA, ne s'en remettra guère avant la fin du siècle. Seule l'introduction de la lithotripsie extracorporelle apportait quelque chose de nouveau pour ressusciter l'UIV, devenue la parente pauvre de l'imagerie médicale. Je présentai là mes observations de suppurations de l'appareil urinaire mises en valeur par l'échographie. Ce ne fit qu'exciter l'aigreur des frustrés. J'étais sur la route du has-beenage.
Je retournai quelques semaines plus tard à San Francisco comme invité du symposium sur les produits de contraste, premier du genre défini à Lyon. Il se tenait dans le tout nouveau Méridien, dans ce quartier de l'Embarcadero totalement reconstruit qui avait aussi déporté Chuck Murphy dans un tourist-trap du Fisherman's Wharf. Le symposium marquait une volonté de rapprochement des deux grands leaders américains évidemment rivaux. Je connaissais bien maintenant Elliott Lasser le Californien et son équipe amputée de Charles Higgins recruté par l'UCSF pour lancer la RMN. Je ne connaissais pas Harry Fisher, basé à Rochester, New York, lui aussi à la tête d'une pépinière de talents et pour la première fois, assis à côté de son «frère ennemi» en produit de contraste. Je vis un colosse aux airs d'Orson Welles, malheureusement handicapé par des séquelles de poliomyélite qui le condamnaient à la petite voiture. Il modérait les débats avec une voix de basse d'opéra ajoutant à sa majesté naturellement jupitérienne. Je fus le seul candidat à l'organisation du symposium européen suivant en principe programmé deux ou trois ans plus tard. Ma présentation fut brève et sobre. J'avais carte blanche pour la mise en route de tout le processus. Elliott Lasser et sa secrétaire Trudi Cantonwine seraient mes conseillers privilégiés.
ICR'85 et préparer CM'87
PRÉPARER CM'87 était la tâche suivante. Le lendemain du vote, j'avais l'esprit libre pour recevoir les représentants des sept firmes productrices d'agents de contraste, convoquées pour un business-breakfast pour définir les bases du symposium CM'87. Ils avaient reçu un petit mémoire préparé en vue d'une discussion que je voulais critique et exhaustive. Nous colligeâmes tous les éléments négatifs des symposia précédents. Il en sortit un modèle qui sera consacré par l'expression «esprit de Montbazon». Il fallait un numerus clausus, mais suffisamment souple pour que les cinq continents soient représentés et que des personnalités encore inconnues puissent être incorporées. Il fallait aussi que les sept firmes soient traitées sur un pied d'égalité : chacune serait représentée par quatre délégués et par trois communications orales inscrite dans le programme scientifique, tous et toutes intégralement choisis par elle, sans aucune censure en provenance du Comité scientifique. L'idée prévalait selon laquelle chaque firme aurait le désir de promouvoir ses meilleurs travaux de recherche, pour faire bonne figure devant leurs concurrents. L'on éviterait ainsi de tomber dans l'hypocrisie habituelle dans laquelle L'on accueillait une participation de l'industrie dans les programmes scientifiques. La délégation française ne représenterait pas plus de dix pour cent du panel et du programme.
La langue officielle serait l'anglais, sans traduction simultanée, à la fois pour des raisons de budget, de communication entre les participants et de place dans la salle de réunion qui devrait rester conviviale. Le symposium serait localisé dans une trappe, c'est-à-dire un lieu duquel les participants seraient de l'impossibilité physique de s'enfuir. Les Américains avaient beaucoup déçu à San Francisco en profitant des facilités de transports pour ne passer que le minimum de temps dans le symposium. Certains prirent l'avion la veille au soir de leur présentation et repartirent dès la fin de la discussion ; d'autres prirent avantage du décalage horaire entre les deux Côtes pour arriver par l'avion du matin et ne passer que quelques heures dans la salle de conférence. Or l'intérêt majeur de réunions de ce genre tient dans les rencontres et les discussions informelles entre scientifiques lors des repas et des soirées. Le choix du Broadmore à Colorado Springs avait rempli ce rôle. Il y eut un peu trop de monde à Lyon, mais, L'on lui avait surtout reproché sa localisation dans un complexe éloigné de la ville et difficilement accessible ; plus grave, les réjouissances gastronomiques et culturelles avaient été trop nombreuses et trop fatigantes ; les scientifiques anglo-saxons sont des couche-tôt qui fonctionnent à l'heure solaire.
Enfin, le symposium serait gratuit pour tous, là aussi pour éviter toute hypocrisie et crises de jalousie. Les sept firmes financeraient à parties égales, sur la base de sept mille dollars chacune, un bon budget de plus de sept cent mille francs. Je pouvais ainsi louer le Château d'Artigny pendant une semaine de printemps. Le propriétaire s'était un peu fait tirer l'oreille, le mois de mai étant très riche en jours fériés. La date avait été choisie afin que les participants puissent également se rendre à Lisbonne, où commençait, dès le week-end suivant, le Congrès européen de radiologie. Il y a une jet-set de la radiologie scientifique et de plus en plus d'occasion de voyager, d'où une certaine forme de symbiose qui peut être très favorable à l'une des réunions et désastreuse pour l'autre. Je savais que j'aurais davantage de prétendants à éliminer que l'inverse.
J'ai mon éthique de la jet-set scientifique à laquelle j'ai appartenu pendant vingt-cinq ans d'exercice ; elle se refuse à organiser ou à participer à des voyages touristiques où la pédagogie et la science ne sont là que pour justifier un avantage fiscal. Les boon-doggles, comme les Américains les appellent, font partie du package des avantages inhérents à la condition académique ; l'on est invité à donner une ou deux conférences, toujours les mêmes pendant des années, et, le reste du temps, l'on va pêcher le saumon en Alaska ou l'espadon dans les Caraïbes aux frais du congrès. Je ne voudrais pas passer pour un vertueux excessif, mais j'ai un code d'honneur. L'on ne fait pas de politique internationale si l'on ne s'inscrit pas pour au moins une communication scientifique originale dans le Congrès que l'on visite, et, de préférence, L'on paye son inscription au congrès, de façon à rester l'esprit libre pour sa mission principale.
À Honolulu, je présenterai devant un auditoire restreint mais professionnel un travail d'avant-garde mené avec les histologistes de Necker sur les effets des nouveaux produits de contraste sur les reins de souris de laboratoire de type Swiss IFFA, réagissant d'assez près comme ceux de l'homme. Les industriels n'aimaient pas mes travaux qui annihilaient ou compliquaient nombre de leurs promotions commerciales, mais ils me respectaient car ils savaient aussi que je ne truquais pas mes résultats et que je vivais médicalement parlant de leurs opacifiants sans lesquels aucune radiologie ne peut progresser à l'avantage des malades. D'où l'immense succès d'estime de la formule audacieuse que j'introduisis à Montbazon. La radiologie française se positionnait ainsi en tête des pionniers de l'éthique industrielle appliquée aux sciences cliniques, un concept alors réputé inconcevable.
7.6.1. PUNTA DEL ESTE, URUGUAY, MARS 1986
Fin mars 1986, je partis pour un tour panaméricain. Les Uruguayens organisaient des journées d'enseignement à Punta del Este auxquelles plusieurs conférenciers français étaient invités et je faisais partie du convoi. Ce fut l'occasion de renouer les liens avec les soutiens de l'année précédente et de nombreux radiologues praticiens du Cône Sud. Ce fut aussi ma première rencontre avec une femme étonnante, prénommée Teresa de Bidart, qui tenait l'agence argentine de la Société Agfa-Gevaert spécialisée dans les surfaces sensibles qui avait organisé ma conférence de l'année passée. Son dynamisme général n'avait d'égal que la passion qui l'animait pour son métier et son désir d'aider à la promotion d'ICR'89 en Amérique Latine où elle jouissait d'une grande popularité. Elle se mit en quatre pour me faire de cette semaine à la fois une courte période de farniente et une percée scientifique en hispanophonie. Le directeur du programme m'avait demandé un titre de conférence ; je lui en envoyai quatre, tous axés sur mon expérience en échographie ; sans trop savoir pourquoi, juste avant de clore la lettre, j'y ajoutai le sujet des accidents de produits de contraste iodés. À mon grand étonnement, tous furent acceptés. Je ne résistai pas à la volupté de m'exprimer de nouveau en espagnol. Je ne manque pas de rendre hommage à la traduction simultanée en français d'une qualité exceptionnelle donnée par la meilleure interprète jamais rencontrée, tous lieux et langages confondus ; le débit survolté dans le parler usuel donne un réel avantage à ces enfants du Rio de la Plata pour la pratique de ce métier difficile.
A la fin de ma conférence sur les produits de contraste, je vis arriver une jeune femme de Cordoba, ville située sur le contrefort des Andes. Elle était la première radiologue d'Argentine à être poursuivie devant les tribunaux à la suite du décès d'un malade dans son cabinet ; l'on lui reprochait de n'avoir pas fait préalablement les tests de tolérance à l'iode, depuis longtemps abandonnés en France parce qu'aussi dangereux qu'inefficaces. Ma conférence l'avait soulagée. En Argentine comme dans toute l'Amérique latine, la position officielle était la même que celle qui prévalait en Europe dans la première moitié du siècle et que Jean-René Michel avait tant combattue avec Coliez, le Club du Rein et bien d'autres, au prix d'un succès qui libérait les rapports d'expertises médico-légales d'une hypothèque faussement scientifique. Je lui promis d'envoyer dès mon retour le tiré-à-part d'un article princeps signé par les noms prestigieux de l'allergologiste René Wolfromm et des médecins légistes Derobert et Guy Dehouve, paru à cette fin dans les Annales de Médecine légale ; ils rapportaient non seulement le résultat d'une vaste enquête effectuée en France, mais aussi les conclusions similaires d'enquêtes nord-américaines concordantes. J'en possédais un, perdu au fond d'un carton, égaré au cours du déménagement ; trop impatiente, elle voyagea à Paris sans me prévenir, pour le quérir en vain ; je lui donnai l'article que j'avais publié dans les Feuillets de Radiologie avec Christian Debras.
7.6.9. LONDRES, UNITED KINGDOM, 1986.
Dennis Carr, un collègue du prestigieux Hammersmith Hospital perdu dans la banlieue de Londres, publiait un livre sur les produits de contraste et m'avait sollicité de rédiger le chapitre consacré à leur toxicité rénale. Je fis la relation exhaustive tant de mon expérience personnelle que des données d'une littérature devenue très épaisse. Mon anglais médical s'était considérablement amélioré mais pas assez pour éviter une révision de mon manuscrit qu'il effectua avec beaucoup de respect pour les idées que j'y développais.
7.6.12. BIOPHYSICA FOUNDATION, SAN DIEGO, CALIFORNIE, JUIN 1986
Milos Sovak avait invité une vingtaine d'experts internationaux à un brainstorming de quarante-huit heures destiné à lancer le programme expérimental de sa nouvelle molécule nonionique, l'iotrolan. Les discussions étaient informelles mais approfondies par un corps de chercheurs beaucoup plus jeunes que ceux du caravansérail d'Elliott Lasser. C'est là que je fis la connaissance d'un certain Henrik Thomsen, un isotopiste danois formé à l'uroradiologie chez Lee Talner, qui voulait se poser sur le terrain de la néphrotoxicité ; il m'impressionnait par sa totale méconnaissance de la néphrologie clinique, mais sa puissance de travail n'avait d'égal que son ambition. Nous étions logés dans le superbe Sea Lodge Hotel et traités comme des princes. Je disposais aussi de beaucoup de liberté et d'une Ford Mustang V8 blanche de location. Lee Talner était hospitalisé pour une complication de diverticulite sigmoïdienne, une maladie dont j'avais déjà expérimenté les inconvénients ; je l'aurai seulement au téléphone, assez contrarié que je sois au courant de ses ennuis ; je lui cachai le nom de mon informateur, mais notre amitié perdit alors une partie de sa fraternité.
7.8. LE CONGRÈS DE LA RECHERCHE DU CERF
Le Cercle des Enseignants de Radiologie de France, le Cerf, organisa son premier congrès scientifique à Paris en mars 1987. Il s'agissait pour Michel Amiel et Guy Frija en fin de mandats, de démontrer que notre discipline avait maintenant sa place dans le concert de la recherche scientifique, à l'image des grandes autres disciplines cliniques. J'avais la charge de la session consacrée aux produits de contraste. Milos Sovak avait accepté de présenter la chimie relativement complexe des molécules iodées organiques, à un moment où l'industrie nous mettait devant une explosion des molécules de faible osmolatité ioniques ou non. J'écrivis une synthèse des connaissances de l'époque sur la toxicité générale, pendant de celle que j'avais achevée en matière de néphrotoxicité. Il y avait deux théories que j'espérais pouvoir lier l'une à l'autre pour le meilleur usage chez les malades de plus en plus couramment soumis à des injections du fait de l'explosion du scanographe et de l'angiographie numérique. L'ossature de la première théorie s'appuyait sur les travaux d'Elliott Lasser, eux-mêmes fondés sur la réaction en cascade à partir du complément sérique que déclenche l'organisme à la moindre agression. Cet exposé permettait de mettre en pièces la trop fameuse et délétère allergie à l'iode. Voici ce que j'écrivais en 1990. Je ne suis pas certain que son contenu soit tellement périmé aujourd'hui.
Si la molécule iodée était un vrai allergène, elle entrerait en conflit avec des anticorps spécifiques fabriqués par l'organisme à partir d'une variété de protéines du plasma, les gammaglobulines. Il en résulterait une cascade de réactions biochimiques complexes aboutissant à la libération de médiateurs de haute toxicité à des doses infimes, perturbant les systèmes de la coagulation et de l'équilibre vasomoteur, dont l'histamine est l'une des plus connues du public. Un organisme sain dispose de gros moyens pour bloquer efficacement l'irruption de ces réactions tant à la base qu'au cours des différentes étapes. Pour stimuler ces défenses ou pallier leurs insuffisances conjoncturelles éventuelles, le radiologue dispose de différentes drogues qu'il utilise à titre de prémédications. Les plus courantes sont les dérivés de la cortisone et les antihistaminiques. Le seul obstacle à l'adoption de ce schéma cataclysmique vient du fait que les accidents généraux des produits de contraste, les grands chocs, ne sont pas d'origine allergique vraie. On ne trouve pratiquement jamais ces fameux anticorps spécifiques chez les personnes examinées après ces accidents. La conduite des radiologues relève donc de l'empirisme et ce qui les désespère le plus vient de notre incapacité à leur donner les moyens de détecter préventivement les personnes dites à risque avec une grande précision. Certains, considérant à la fois notre ignorance et la précarité de nos moyens prophylactiques parfois eux-mêmes dangereux, injectent les produits de contraste sans aucun recours aux parapluies chimiques. D'autres, infiniment plus nombreux, préfèrent mettre toutes les chances de leur côté et associent plusieurs types de drogues, selon des schémas plus ou moins inspirés par l'expérience de leurs réanimateurs. On ne peut donner tort ni aux uns ni aux autres, mais il en résulte une atmosphère faite de frustration et d'anxiété, voire de culpabilité. Aucun radiologue n'aborde ce problème avec légèreté.
La seconde théorie était défendue alors solitairement ou presque par un collègue de Cleveland, ancien collaborateur de Meaney, Anthony Lalli. Elle mettait en valeur le rôle prédominant de l'anxiété, celle du malade comme celle du radiologue. Elle ne s'exprimait pas par des données chiffrables mais elle faisait entrer en lice les effets du stress décrits par le Canadien Hans Selye. Lorsque l'on a l'habitude de l'emploi des produits de contraste iodés, force est de constater que l'angoisse joue un rôle considérable dans la violence de l'expression des manifestations cliniques d'intolérance, sinon dans leurs déclenchements eux-mêmes. L'hostilité que Lalli déclancha chez ses confrères fut telle qu'il dut s'expatrier au Canada et y terminer sa carrière dans l'anonymat, me confia Meaney.
Je me souviens, comme si c'était hier, de la première urographie intraveineuse que j'ai fait subir à une jeune sylphide aux tout premiers jours de mon internat chez Ledoux-Lebard en 1967. Jeune héritier d'une longue tradition de méfiance des médecins internistes vis-àvis de cet examen à la réputation sulfureuse que je faisais pour la première fois, j'étais plus terrorisé que ma patiente elle-même, seulement un peu nerveuse. Aidé par une manipulatrice peu expérimentée mais respectueuse, je me sentais dans un état d'isolement médical total, en ce début d'après-midi de printemps. A cette époque-là, la dose était une ampoule de vingt centimètres-cube de diodone. Les tests à l'iode avaient été faits scrupuleusement sans résultats inquiétants. La jeune femme n'apprécia pas outre mesure la piqûre avec une aiguille à biseau long d'une veine cependant facilement accessible de son avant-bras droit et ponctionnée sans difficultés techniques, comme en témoigna l'aspiration d'un peu de sang dans le corps de la seringue en verre. J'injectai sans réaction antagoniste la première goutte recommandée par les manuels. Je commis alors deux erreurs. La première fut d'injecter le liquide avec une extrême lenteur, en ne manquant pas de fréquemment aspirer du sang, ce qui eut pour effet de traumatiser la paroi veineuse. La seconde fut de harceler la jeune femme de questions destinées à savoir si elle ne ressentait pas ci ni ça. Tant et si bien qu'au milieu de l'injection, elle se tortillait sur la table en tous sens et devenait blanche comme un linge ; l'aiguille perfora la veine et le liquide visqueux se répandant dans les tissus produisit une sensation de cuisson. Je dus arrêter tout et renvoyer la jeune femme sans avoir pu prendre un seul cliché. Rien là-dedans ne relevait d'une quelconque allergie à l'iode. Il n'y avait qu'inexpérience, incompétence et nervosité de ma seule part. Ce sera une des grandes leçons formatrices de mon métier de radiologue et d'enseignant.
Je ne crois pas exagérer en affirmant dans ce chapitre que Jean-René Michel aura été le grand libérateur de l'obsession inhibitrice des pionniers de la radiologie, en mettant en exergue la primauté de l'indication des examens à réaliser impérativement pour obtenir un diagnostic. Comme l'inscrivirent l'allergologue célèbre de l'hôpital Rothschild René Wolfromm et ses collaborateurs en chapeau de leur enquête sur les accidents de l'UIV : «Plus de malades sont morts d'une absence d'urographie qu'il n'y en eut en raison même de la technique de la radiographie». La chasse aux examens inutiles était lancée, ce qui ne signifiait pas que les radiologues avaient des permis illimités de tuer leurs clients dans l'inconscience et l'impunité. Les poursuites judiciaires s'annonçaient courantes en radiologie comme ailleurs en médecine.
Michel avait tiré des conclusions positives d'un accident rarissime observé au cours d'une opacification d'une veine rénale compliquée d'une coagulopathie de consommation avec fibrinolyse aiguë de très mauvais pronostic. La pharmacopée mettait à la disposition des thérapeutes de ces accidents des substances antifibrinolytiques, dont l'acide epsilonaminocaproïque qui était doté de propriétés antichoc. Michel avait remarqué que l'emploi de la seule deltacortisone n'avait que des effets inconstants sur la prévention des collapsus. Par contre, il n'avait enregistré aucun échec depuis qu'il associait les deux molécules, ainsi qu'il l'avait rapporté au symposium de Lyon à partir d'une grosse statistique qui avait impressionné Lasser lui-même. Je l'avais suivi dans cet optimiste pendant une bonne dizaine d'années, y compris quand j'avais été soumis moi-même à une UIV, effectuée dans les règles pendant mon épisode de diverticulite sigmoïdienne de 1980. J'avais abandonnée l'acide ∑-aminocaproïque après mon retour de San Diego, faute de pouvoir intégrer ce paramètre dans un schéma biologique cohérent. Il arriverait un moment où il y aurait des accidents d'intolérance à la prémédication et il ne fallait pas tenter le diable sans être couvert par des autorités compétentes en biologie ; or elles étaient plus promptes à s'exprimer oralement que par écrit sur ce sujet, quand il s'agissait de se prononcer définitivement. Lorsque, pendant une à deux décennies, on se trouve dans un établissement où l'on pratiquait volontiers une cinquantaine d'UIV tous les jours ouvrables, comme à Necker dans les années 70, l'on savait de quoi on parlait quand il s'agissait d'affronter des problèmes cliniques complexes ; un radiologue moins expérimenté ne pouvait les assumer sereinement dans un cabinet libéral de sous-préfecture. Un capitaine au long cours n'est pas un régatier du dimanche à la Baule-les-Pins. On ne s'attaque pas aux quarantièmes rugissants avec un Beluga.
Un soir de 1973, je reçus à Necker une manipulatrice de radiopédiatrie que je connaissais bien, ce jour-là catastrophée. Elle revenait de vacances familiales heureuses en Bretagne jusqu'à ce qu'elles tournent au cauchemar quand son mari se mit à uriner du sang. Très logiquement, alors que l'échographie n'existait pas alors, son médecin prescrivit une UIV effectuée à l'hôpital préfectoral. Malheureusement, l'injection déclencha un choc cardiovasculaire immédiat et l'homme dut être hospitalisé en réanimation sans qu'aucun cliché ait pu être fait. Il avait vu la mort de très près et ce qu'il racontait n'avait rien de rassurant. Il avait néanmoins survécu et le problème de l'identification de la cause de son hématurie restait entier, alors que la cystoscopie était normale. Seule l'UIV pouvait faire avancer le problème qui risquait de se situer au niveau des reins ou des uretères, une lithiase urinaire calculeuse sans doute mais peut être aussi un cancer. L'homme étant dans la force de l'âge et cuisinait dans un restaurant gastronomique réputé où la chaleur des fourneaux n'est pas un vain mot quand il s'agit de déshydrater les gens. D'où le drame que le couple vivait, car l'urologue insistait à juste titre. Le radiologue, devant un symptôme comme une hématurie, sait ce qu'il cherche mais ne le trouve pas nécessairement. En revanche, il lui arrive souvent de découvrir des maladies qu'il ne soupçonnait pas. Cet homme-là était une sorte d'urgence diagnostique, mais pas au point de voir la mort repasser une fois encore avant son heure. J'avais une foi de charbonnier dans la protection qu'assurerait la prémédication selon Michel qui nous racontait chaque semaine des histoires similaires qu'il avait maîtrisées ainsi. Je discutai longuement avec le mari et l'épouse et le rendez-vous fatidique fut pris aussi bien sur la table de radiologie qu'avec l'anesthésiste-réanimateur qui serait là en permanence avec son chariot et ses fluides. Toutes les précautions médicamenteuses furent prises et, comme il fallait cesser de marcher à reculons, je conclus les préliminaires par un pari. Si tout se passait bien, il m'inviterait dans son restaurant, et il n'y aurait pas de sinon. Je n'aurai pas cette récompense, puisqu'il lui poussa une seule papule d'urticaire mais rien de plus grave. Peu importait, l'examen s'était déroulé exactement comme je l'avais décrit, y compris dans ses phases les plus délicates et l'urologue n'avait plus qu'à décider de la thérapeutique à appliquer à la lésion identifiée dont j'ai oublié la nature.
Elles alimentent l'enseignement des élèves et des collaborateurs. Les Anglo-Saxons en sont particulièrement friands. La médecine est un art difficile et il ne faut jamais sombrer dans le triomphalisme non plus que dans sa propre autodéification. Dans d'autres mains, dans d'autres endroits, la prémédication de Michel s'avéra inefficace voire dangereuse voire mortelle. La fragilité de l'argumentation des théories, savantes ou non, tient plus à l'usage immodéré du syllogisme aristotélicien que de la rigueur scientifique multiparamétrée. À ce moment aussi, le rationaliste butte sur les défaillances du principe d'égalité de tous devant une situation médicale dont l'effet pervers est l'érection de la statue du mandarin-commandeur des croyants, ou son contraire, le nivellement sur la base de la technocratie statistique édictée en dogme binaire informatisé. La personnalité de chaque praticien joue un rôle dans l'efficacité diagnostique et thérapeutique. Ce côté subjectif fait la réputation d'un individu dans un exercice donné plus sûrement que l'exhibition de ses peaux de bique acquises depuis déjà trop longtemps. Les drogues magiques de mon père perdaient une grande partie de leur efficacité dans les miennes et lui, plus chevronné, n'essayait même pas de vérifier l'exactitude de l'échange en sens inverse de mes recettes perso. D'où l'importance majeure que j'accorde à la qualité du colloque singulier qui fait le lit authentique de la sécurité. D'où la valeur pédagogique exemplaire du vécu dans sa chair même de malade-médecin de ce qu'on va prescrire à l'autre. Avec ce prérequis, bien entendu non obligatoire en régime démocratique éclairé, l'on peut mettre un terme à des jérémiades ou des enfantillages dérivant de lectures de vulgarisation mal digérées ou du colportage d'histoires de bonne femme ou de comptoir jamais anodines. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on pique avec du matériel moderne, aiguilles à usage unique bien affûtées et aseptiques, seringues en plastique empaquetées qu'il ne faut plus faire bouillir et pétrifier dans la casserole d'eau du robinet sur la plaque de butagaz avant usage comme il y a cinquante ans, fine tubulure en polythène souple conservée à demeure pendant une bonne heure ou plus. Les malades sont aujourd'hui des enfants gâtés par rapport à leurs grands-parents, mais la prévention du sida et autres saletés nosocomiales vaut bien cette dépense. Je sais tout de la bouffée de chaleur produite par l'injection, de la nausée intempestive et sans gravité quand L'on n'a pas voulu rester strictement à jeun, du désagrément de la compression urétérale par un ballon pneumatique trop ou mal gonflé.
Nos patients soumis à l'indication d'une UIV ou plus souvent maintenant d'un scanographie ou d'une IRM ont le choix plus ou moins conscient ou réflexe entre trois attitudes de défense devant l'inconnu qui les attend. Il y a ceux qui, par nature sans inquiétude ou sans méfiance, ne demandent au médecin que de faire son travail et de le faire bien. Ils ne viennent pas pour une partie de plaisir mais ils sont durs au mal et ne dramatisent pas à outrance. Quoiqu'ils ne soient pas invulnérables, pourquoi les inquiéter à l'américaine en leur assénant la litanie des catastrophes qu'ils vont certes frôler mais de très loin ? Il suffit de les bien accueillir, de répondre à leurs questions s'ils en posent et de ne pas les laisser mariner dans un désert de silence ou de solitude. L'accueil impersonnel de la radiologie est une constante dans les récriminations justifiées des malades, notamment dans les consultations hospitalières ; ses causes en sont variées et plus ou moins facilement contrôlables, depuis la crise du personnel jusqu'à l'absence d'éducation aussi bien des malades que du personnel médical ou non. Il y a en effet ceux qui ne dramatisent pas mais voudrait savoir, ne serait-ce que le temps que ça va prendre et la forme dans laquelle ils seront quand ce sera fini et qu'ils vaqueront à leurs affaires. Il faut leur dire la vérité et la part d'imprévisibilité qui résulte de tout acte médical réfléchi, sans pour autant faire surgir une angoisse maladive qui ne s'impose pas. On sait que certains gros durs qui ont fait la guerre sont capables de décompenser brusquement, sans prévenir, parfois à leur grande surprise. Il ne faut faire le procès de personne, combien de médecins ne sont-ils pas de grands hypochondriaques capables de crises théâtrales à la vue d'une seringue armée d'une aiguille en direction d'une partie de leur individu ? Et il y a tous les autres, les plus nombreux, qui sont vraiment angoissés parce qu'ils ont expérimenté une complication à l'occasion d'examens antérieurs, ou qu'ils ont entendu parler de sensations cauchemardesques, ou qu'ils sont douillets, ou simplement parce qu'ils sont dans le vide de l'inconnu mais ni inconscients ni inconséquents. Qui sait si ces états troubles préparent la défense de l'individu contre l'acte agressif utile qui va suivre ou, au contraire, l'annihilent ? Il faudrait pouvoir ouvrir une vraie consultation prophylactique informant le malade en prenant son temps et dans un local adapté quand, regrettablement, on ne peut le plus souvent être qu'expéditif. Certains savent toutefois forcer les barrages et ils n'ont pas tort de tenir à leur peau.
L'homme a une soixantaine d'années et n'est rien d'autre en apparence qu'un grand bébé poupin et grassouillet au teint diaphane, sans muscles, au demeurant un grand pianiste de concert et une caricature d'homosexuel passif. Il a comme beaucoup d'hommes de son âge quelques difficultés à faire pipi et, l'urologue a été formel, il doit subir et bénéficier en même temps d'une urographie intraveineuse, en ces temps où l'échographie prostatique n'existe pas encore. Durant les huit jours précédents, il ne manque pas une seule occasion de m'appeler au téléphone sans parvenir à épuiser un stock sans fond de questions plus ou moins fantasmagoriques. Savoir écourter un entretien trop bavard fait partie de l'apprentissage du savoir-faire médical. Il arrive à son rendez-vous avec une bonne heure de retard mais, à cette époque de l'année où les jours sont longs, mon agenda n'est pas trop bousculé. Il est venu quand même pour me dire que, non, décidément, il ne peut pas, il a très peur et renonce à son UIV. Je parlemente pendant une dizaine de minutes pour le raisonner. Il accepte de se rendre dans le déshabilloir. Ah ! mais non, décidément il ne peut pas, même après avoir suspendu sa veste au portemanteau. Mais si ! et il finit par se mettre torse nu et le cirque recommence. Il faut quand même mettre un terme à cette tragi-comédie et je l'engueule à voix ferme et douce, sans méchanceté mais sans concession. Je lui rappelle qu'il a pris rendez-vous au détriment d'autres personnes car la liste d'attente est longue, qu'il est responsable d'un retard qui maintenant dépasse quatre-vingt-dix minutes et que les malades suivants en pâtissent déjà, ce qui manifestement d'ailleurs l'indiffère. En conclusion, je lui donne une minute montre en main pour qu'il se décide à s'allonger sur la table ou à décamper, alternative qui le choque profondément. Il s'effondre alors dans un fauteuil, écarte les bras, me regarde droit dans les yeux et me lance comme un javelot la phrase assassine : «Et si je meure, docteur, ce sera votre faute !» Non, monsieur le virtuose, ce ne sera pas de ma faute et, bien sûr, tout se déroula sans la moindre complication. À la fin de l'examen, il se relèvera avec une lueur de triomphe dans le regard, plus admiratif de son courage qu'honteux d'un cinéma qu'il a totalement chassé de sa mémoire. Il en oublierait presque de régler mes honoraires qui auraient pu être largement doublés tant les exigences particulières de ce malade m'avaient fait perdre mon temps, il est vrai beaucoup moins précieux que le sien. À la fin de son exercice, mon père, légendairement patient, ne supportait plus cette désinvolture si courante dans les campagnes d'alors, aujourd'hui minorée tant les manques d'éducation sont courants des deux côtés du stéthoscope.
Pendant des années, j'ai couru après une formulation, on dit aujourd'hui un paradigme, assez claire et rapide pour répondre aux questions des malades sur les risques encourus. Faut-il se fier aux statistiques ? La plus terrible était alors celle d'un Américain qui faisait état d'un décès sur dix mille examens, ce qui est énorme et inadmissible quand on se réfère à l'expérience de Necker proche de un sur cent cinquante mille. L'expérience de ma collègue lyonnaise Annick Pinet excipait de résultats similaires bien qu'elle eut une approche sensiblement différente en matière de prémédication. L'UIV tuait plus au Royaume-Uni qu'en France. Cela s'expliquait-il par la brutalité de l'informed consent ? par l'imprécision clinique du fourre-tout des manifestations d'intolérance souvent mises en classement opportuniste pour justifier telle ou telle position ? Le Japonais Hiroki Katayama, invité à Montbazon, allait brouiller les cartes pour des années avec une statistique démontrant l'innocuité d'un nonionique d'origine germanique, manifestement outrancière mais industriellement intéressante à promouvoir.
Qui pourra me rappeler le titre du film de Woody Allen de la fin du siècle dernier dans lequel il a réussi à placer dans les dialogues une réplique à tonalité médicale certainement ésotérique pour l'immense majorité des spectateurs, quand il annonce à sa partenaire qu'il va être soumis à une scanographie : il est paniqué par la réponse qu'il doit donner à son radiologue à la question «Ionics or nonionics ? », en application des recommandations de l'American College of Radiology ? Je me demande si elle n'a pas été coupée dans la version diffusée en France, faute de n'être pas davantage comprise que le Manurhin de Godard-Belmondo.
J'avais fini par briefer mes malades avec une comparaison simple. Vous avez moins de chance de faire un accident grave d'UIV ou d'artériographie ou de scanner que vous, piéton, de vous faire écraser par une voiture en traversant la rue de Sèvres pour entrer dans l'hôpital Necker. J'avais ce privilège de crédibiliser mon assertion par ma connaissance des dossiers scientifiques et médicolégaux des deux côtés de l'Atlantique et d'avoir moi-même, je le répète une fois de plus, subi ces examens agressifs. Il m'est arrivé, comme à nombre de mes collègues, de sentir mon malade filer entre mes doigts, mais j'ai eu cette chance de pouvoir bénéficier de l'extraordinaire support de mon regretté collègue et ami Christian Debras. Cet anesthésiste-réanimateur de Necker, élève de Maurice Cara, l'inventeur du Samu de Paris, m'avait aidé à formaliser un abord de l'urgence en salle de radiologie à l'usage des étudiants du CES de radiologie, un concept fondé non pas sur une philosophie biologique bavarde et pseudoscientifique, mais sur des considérations purement pratiques accessibles à tout étudiant ayant passé avec succès un baccalauréat, donc à un médecin comme à un infirmier. Avec Debras, malheureusement exilé à Henri Mondor, puis avec ses élèves Louville et Cazalaa, nous aurons à Necker, nous les radiologues mais aussi et surtout nos malades, le privilège de pouvoir mobiliser à la minute ces fabuleux pionniers de l'urgentisme qui sauveront pratiquement tous nos patients intolérants à la pharmacopée radiologique d'une mort certaine ou de complications gravissimes. Je crois également à l'efficacité de l'enseignement post-universitaire propagé intensivement dans toute la francophonie par le biais de la Société Française de Radiologie, dans notre politique de sécurisation des cabinets libéraux et des hôpitaux généraux qui contrasta longtemps avec l'insécurité ressentie à l'étranger beaucoup moins solidement structuré que dans l'Hexagone. Je l'expose d'autant plus volontiers que je n'ai plus de responsabilité dans ce domaine et que, si j'ai désapprouvé nombre de «recommandations de bonnes pratiques» récentes, je n'ai jamais polémiqué pour imposer les miennes au détriment de la sécurité de la population en général.
Il appartient à chaque génération de définir ses propres paradigmes ! Le temps m'aura manqué pour développer une étude scientifique destinée à statuer sur la pertinence de ma conception du «trou biologique» qui peut rendre tout être humain «normal» extemporanément vulnérable à une agression intempestive, radiologique ou non, prémédiquée ou non.
Je regrette que la théorie de la mémoire de l'eau émise par Jacques Benveniste, que j'avais bien connu à Necker, se soit effondrée dans une sombre histoire de méthodologie qui faillit berner le périodique Nature, monument de la presse scientifique ; elle aurait pu expliquer pourquoi des humains totalement vierges de toute pathologie apparente développent des chocs anaphylactiques, alors qu'ils n'ont jamais été supposés avoir été au contact de la substance qui va les tuer irrémédiablement en une fraction de seconde.
7.9. CONTRAST MEDIA'87, MONTBAZON, INDRE&LOIRE, MAI 1987
Pour en revenir à ce printemps de 1987, le succès du congrès du CERF fortifia la réputation croissante de la radiologie scientifique nationale qui se répercutera sur ICR'89. Des rumeurs se propageaient sur mon état de fatigue. Si elles se dissipèrent également à la suite de ma conférence, elles avaient leur raison d'être et je dus faire face à un grand état d'épuisement confinant à l'effondrement dans les trois semaines qui précédèrent le symposium de Montbazon. J'en porte l'entière responsabilité. Durant tout l'hiver, les propositions de communications avaient afflué de plus en plus nombreuses, de plus en plus diversifiées, étendues au paramagnétisme comme aux microbulles ultrasonores. De petites sociétés s'étaient manifestées et devaient être incorporées. Le nombre de participants atteignait quatre-vingts inscrits à l'origine d'un programme potentiellement fastueux à étaler sur cinq jours, puisqu'il n'y aurait aucune session parallèle et que le temps réservé aux discussions formelles s'étendrait à plus d'une heure par session de deux heures. De nombreux chercheurs émergeaient de tous les continents et j'avais ma demi-douzaine de Japonais, mes Australiens et même un hispanophone. Si les Français ne dépassaient pas le contingent de dix pour cent que j'avais fixé à Hawaï, ceux qui étaient invités arrivaient avec de remarquables travaux. Le château d'Artigny ne suffisait plus et il me fallut loger un bon tiers de mes invités dans des hôtels du voisinage, un problème qui se révélera moins conflictuel que je ne le craignais, quoique la vie de château fut un privilège réservé aux anciens et aux personnes à honorer.
Je pris un très grand plaisir à composer les menus offrant la gastronomie la plus légère possible afin que nul ne sorte de table gavé de quoi s'endormir dans la salle de conférence voûtée, à peine assez grande pour tenir toute l'assemblée. J'imposai l'exclusivité des vins de Touraine qu'un seul invité, l'un des vulgaires nouveaux riches habitués des cirques du paramagnétisme américain, traita de second choice, mais dut ciller sous mon regard méprisant. Les scientifiques anglo-saxons ne sont pas des baffreurs à midi, mais se défoulent volontiers le soir, à condition de se coucher tôt. L'ambiance générale aux repas sera exceptionnellement libre et chaudement amicale chez ces personnages habitués à se haïr plutôt qu'à s'entendre convivialement. J'avais préparé avec Mademoiselle Dasque, de l'Office du Tourisme de Touraine, un programme de réjouissances pour les dames qui alliait la légèreté élégante du Val de Loire à la découverte de curiosités alors moins connues, comme le musée consacré aux machineries de Léonard de Vinci. Toutes seront ravies. Phyllis Lasser, définitivement séduite par ces maudits Français, n'y trouvera pas la moindre imperfection. Jean-Pierre Ouvrard et ses choristes nous offriront un merveilleux concert de musique libertine de la Renaissance qui sera l'un des ses derniers avant sa mort prématurée. Son jeune chef refusait obstinément toutes les propositions d'enregistrements professionnels ou amateurs de ses concerts et il n'en existe aucune discographie.
En attendant cet épilogue, j'étais tombé en panne d'influx à la période où j'aurais dû avoir imprimé les plans du Symposium qui ouvrit avec tout le matériel brut nécessaire mais sans autre programme que celui de la première session. Elliott Lasser, réprobateur, ne s'y attendait pas et il fallut improviser tous les jours le programme des sessions. Geoffrey Benness, Ronald Grainger, Harry Fisher et Gerald Wolff nous assistèrent avec efficacité. Nicole Laborie, Armelle Tiercelin, Sophie Tixier, Trudi Cantowine et ma femme se chargeront du confort des invités ; Marc Giwerc déploiera sa capacité de séduction au service de la relation publique et de l'assistance technique. Je reste persuadé que c'est cette imperfection humaine au milieu d'une perfection du décorum et la distinction des cerveaux qui feront l'alchimie de ce moment inoubliable qui marquera l'esprit de Montbazon dont L'on parlera encore vingt ans après. Par contre, à cause de mon marasme, Milos Sovak et moi échouerons dans notre projet de créer en ces lieux une Contrast Media Society. J'avais à faire face à un déficit financier important ; les représentants de l'industrie, ravis par le succès de ce symposium, s'en doutaient et ne voulaient pas que je l'assume seul ; ils ne sauront jamais combien ils auraient dû ajouter à leurs contributions initiales, si j'avais accepté cet extra que l'honneur m'obligeait à refuser. Je vendrai mon Alpine à cette occasion, principalement parce qu'elle venait d'être vandalisée pour la troisième fois dans un parking couvert. J'achèterai une Fiat 500 fabriquée en Pologne, aussi humble que sûre.
7.32. SYDNEY, AUSTRALIA, OCTOBRE 1989.
J'arrivai à Sydney le lendemain. Un message m'attendait avec une invitation à un dîner intime chez Geoffrey Benness. Il avait à faire face à ce qui pouvait être considéré comme une catastrophe. La compagnie d'aviation intérieure Ansett était en grève dure et interminable pour un conflit compliqué de débauche et de démission de l'ensemble des pilotes. Les grèves de transports sont une des crises les plus graves qui peuvent affecter les voyageurs internationaux et les organisateurs de congrès. ICR'89 en avait été épargné l'exception de celle d'UTA qui avait perturbé le voyage de Lenny Tan. Celle d'Ansett était dramatique pour Geoff qui avait prévu de tenir son symposium à Hamilton Island entre Cairns et Brisbane, sorte de paradis terrestre australien ouvert sur la Barrière de corail. L'exotisme, un radiologue reste un être humain attiré au moins autant par le tourisme que par la science, est attractif surtout quand le lieu est à 20 000 km de chez soi ; pour beaucoup c'était une première et sans doute la seule opportunité de découvrir l'Australie. Sydney est une ville superbe dans un cadre de baies tourmentées. Il faisait beau dans ce début de printemps. Geoff fit un argumentaire exceptionnel. Il joua dans toute son intelligence et de sa séduction dans le but de fixer ses invités à Sydney dans l'hôtel Continental et faire avaler à beaucoup de « unhappy fews », sans lynchage, la pilule amère.
Le symposium fut intéressant mais sans grande surprise. Le sommet fut une présentation par Hitoshi Katayama, le successeur de Tokuro Nobechi, d'une très grande enquête sur la fréquence et les types d'accidents de produits de contraste iodés au Japon. Ce n'était pas un scoop à proprement parler. Il avait présenté ses résultats sous forme de poster à Chicago l'année passée et de communication orale à Paris. Mais c'était la première fois que l'on pouvait en discuter entre spécialistes. La Société japonaise de radiologie avait créé un comité d'enquête à l'échelle nationale pour étudier les conséquences des injections de ces produits sur près de 350 000 malades. Jamais on n'avait nulle part mené une si large enquête. Les résultats faisaient apparaître une sécurité plus grande lorsque l'on injectait les produits de contraste non ionique. Cela pouvait déclencher des tempêtes en Europe et surtout aux USA. Si on appliquait aux pieds de la lettre les conclusions de Katayama, l'on n'avait plus qu'à éliminer tous les produits de contraste hyperosmolaires classiques et adopter les molécules non ioniques. Cela revenait à quasiment tripler les prix dans des pays comme la France ou les décupler aux USA. C'était une sorte de querelle des anciens et des modernes. Chacun avait son analyse des travaux japonais, soit pour justifier l'usage préférentiel de produits onéreux, soit pour réhabiliter les produits ioniques dont ils démontraient après tout ils ne sont pas si toxiques que l'on l'imagine souvent. Le Collège américain créera une commission d'enquête pour vérifier la pertinence de la valeur de la méthodologie des travaux et ses conclusions seront ambiguës. Loin du monde à Sydney, rien n'incitait à des polémiques virulentes. L'industrie concernée, elle, utilisera largement les travaux japonais pour inonder les radiologues et les médecins d'arguments en faveur des non ioniques. L'on pouvait seulement s'étonner que l'article de Katayama fût cosigné par un médecin allemand appointé par l'agence japonaise de Schering A. G.
L'ambiance était excellente et le dîner d'adieu fut des plus déchaînés. Il n'y eut pas de majorité pour créer une société savante internationale. Elle avait été présentée par Milos Sovak trop mollement soutenu par Elliott Lasser. Milos avait échoué et dans la promotion de la société et dans celle de son non ionique, l'Iotrolan pour laquelle il était en procès avec une firme danoise.Mon retour à Necker excita les désirs des auteurs de grands traités pour que je fasse des chapitres de synthèse de l'évolution de l'imagerie en uroradiologie. Le premier à saisir l'occasion fut Jean-Pierre Grünfeld, le successeur de Jean Hamburger, qui me demanda une grande contribution pour le livre « Oxford Book of Clinical Nephrology» qu'il éditait avec de prestigieux néphrologues européens. J'étais embarrassé, comme je le serai tout au long de la décennie 90, par la maîtrise totale des techniques disponibles dans les années 70, qui avaient permis une remarquable réédition du tome 1 du Traité de Fishgold, chez Masson, rapidement épuisée. J'avais manqué l'introduction de la scanographie et de l'IRM, comme l'angiographie numérisée et l'échoscopie de l'appareil urinaire ; je ne pouvais donc pas écrire une bonne revue qui serait témoin de son temps et homogène, puisqu'il faudrait s'adjoindre des co-auteurs qui n'auraient pas nécessairement les mêmes opinions que moi ; par ailleurs, toute contribution au monument exhaustif et imposant qu'est un traité serait publié avec beaucoup de retard, alors que la discipline évoluait avec des avancées foudroyantes dans tous les domaines de la technologie de l'imagerie ; la vérité d'aujourd'hui serait celle d'hier et celle du lendemain serait déjà dépassée par celle de l'après-demain. L'excès de vertu est le péché d'orgueil de la modestie, mais la rançon de l'honnêteté. Je conseillai à Jean-Pierre Grünfeld de faire appel à d'autres auteurs, signant en leurs noms des chapitres dédiés, tels Dardenne pour l'ultrasonographie, et Joffre, de Toulouse, pour l'angiographie rénale. J'écrivis l'uroradiologie conventionnelle, dont je continuais de défendre la version neckerienne orthodoxe à la Michel, à mon sens aménageable en fonction des progrès dans le domaine des produits de contraste et de traitement informatique de l'image, mais inaliénable dans son principe de globalité par inclusion systématique de la cystographie descendante dans les deux sexes. Je saurai toujours gré à Olivier Hélénon de maintenir ce cap, qui fit la suprématie de l'uro-néphrologie neckerienne, par rapport aux autres écoles, en conservant la maîtrise de toutes les techniques jusqu'à l'apparition de l'uroscanner, dont Tavernier et moi avions, dès 1980, pressenti l'irruption que consacrera plus tard Alain Dana, lui aussi pénétré de la même culture.
A RAVENSBRÜCK


LA PHARMACIE DE MARGUERITTE CHABIRON
A VERDELAIS ETAIT DANS CET IMMEUBLE

LES RESISTANTES S'ENFUIRENT PAR LE JARDIN A PIC