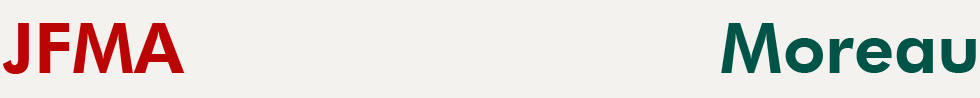MAI 1968 ET MOI
Extrait de "Mémoires Linéaires"
... Les Parisiens n'étaient pas conscients que la situation vécue quotidiennement par les étudiants et certaines catégories de médecins devenait de moins en moins tolérable. Je serais de très mauvaise foi si j'affirmais que j'avais prévu les évènements de mai 1968, mais mon diagnostic sur l'état de la médecine universitaire était clair. Les étudiants n'étaient pas enseignés. Sauf dans quelques établissements privilégiés, ils désertaient une Faculté centrale unique qui leur proposait un enseignement hétérogène. Ils désertaient également les services hospitaliers le matin parce qu'ils étaient de plus en plus laissés à eux-mêmes, faute d'encadrement et de motivation. Externes - et les plus motivés y parvenaient maintenant rapidement - leur assiduité était inversement proportionnelle à leur ancienneté. Je n'expliquais pas autrement le succès de mes conférences d'externat, ne serait-ce que parce que je leur prodiguais une attention responsabilisante. Je voyais, sans rien dire mais avec les nausées de l'homme qui avait dû lutter des années pour obtenir ce titre, la fréquentation des services les moins structurés diminuer de plusieurs matinées par semaine. « Chut ! me disait-on parfois, les externes travaillent l'internat »... Oui, mais partout sauf à l'hôpital et à la Faculté. Cela expliquait nombre d'échecs définitifs ou de succès trop tardifs pour que le souvenir de la préparation ait été bon. On était nommé externe en deuxième ou troisième année de médecine. On préparait mal son premier concours qui avait lieu au début décembre. On préparait l'oral dont les résultats se proclamaient au printemps suivant. Reçu au premier concours, ce qui était toujours rare, on se ne savait pas grand-chose. Collé on se remettait à préparer une deuxième session avec un train de retard. Les nominations les plus régulières étaient au second concours, mais on était nommé de plus en plus souvent au quatrième voire au cinquième essai. L'interne était un monsieur - encore plus souvent qu'une dame, mais la sex-ratio ne tarderait pas à s'inverser - qui ne brillait pas par un excès de générosité gratuite. Fonctionnel à l'hôpital où il avait toutefois trop de malades sous sa responsabilité, ce qui était problématique lorsqu'il se voyait flanqué de mauvais externes, il disparaissait l'après-midi, en principe « pour faire des ménages ». Les-contre-visites globales pour le service se faisaient au tour de bête. La confection des listes de garde en médecine était d'autant plus conflictuelle que les internes étaient plus nombreux dans un hôpital donné et qu'il fallait penser au programme des vacances. Les internes de garde en chirurgie étaient habitués à avoir des gardes fréquentes, mais ils y apprenaient leur futur métier. Les plus mal lotis étaient les internes des services d'obstétrique, de garde un jour sur deux dans un hôpital comme Beaujon où je retrouverai plus tard mon premier externe. Il n'était plus question de rendre des services à titre gratuit ou à des tarifs dérisoires. Les directrices d'écoles d'infirmières se désolaient de ne plus trouver suffisamment de professeurs traditionnellement fournis par l'internat, sans essuyer des avanies : « pas d'intérêt, pas de considération, pas d'argent ». Certes, cette caricature ne correspondait qu'à une minorité, mais elle était assez forte pour déstabiliser l'ambiance qui régnait entre médecins et personnel infirmier et le « petit personnel soignant ». Un médecin hospitalier sans ses infirmières n'est rien, mais il était de bon ton de ne pas en tenir compte. L'Assistance Publique payait très mal et faisait travailler intensivement six jours par semaine des filles qui étaient censés se sacrifier au nom de la vocation, bien contentes quand elles réussissaient à mettre le grappin sur « le » médecin et le traîner à la mairie.
L'année 1968 avait commencé avec le triomphe de Killy aux Jeux Olympiques de Grenoble, mais aussi avec le conflit larvé puis ouvert de Langlois et sa Cinémathèque face aux pouvoirs publics désireux de mettre la main sur ce trésor qu'il avait pourtant fondé mais qu'il entretenait mal. Je suivais dans « Combat » ce qui allait devenir la « trigger zone » française d'évènements internationaux infiniment plus graves. J'avais repris des forces avec une semaine de sport d'hiver à Zermatt. J'avais quitté avec soulagement la Salpe pour un environnement beaucoup plus souriant où j'étais le bienvenu et où ma femme était bien installée et heureuse chez Seringe. Le 27 avril, je saluai mon entrée dans le statut romain de l'homo vir, mais je ne me sentais pas encore un adolescent achevé en passe d'entrer dans la tranche des adultes: j'avais encore trop à apprendre et je n'avais toujours pas d'enfant. La contestation allemande avec Rudy Duschke grondait. L'atmosphère à Paris devenait de plus en plus électrique, des manifestations de masse se succédaient pratiquement quotidiennes place du 18 juin et les boulevards afférents. Je me rendais à pied à l'hôpital et j'avais tout le loisir de voir la parfaite organisation des cortèges qui, pour éviter les échauffourées avec une police encore spectatrice, se découpaient en phalanges contenues par des lignes d'individus qui se tenaient bien serrés les uns à côté des autres par l'enlacement de leurs bras, en tournant le dos aux manifestants défilant à l'intérieur du carré ou du rectangle ainsi bouclé et protégé.
Je n'ai vécu les évènements préliminaires du Quartier Latin que par la presse écrite et la radio. Je passai la journée du 13 mai 1968 à l'hôpital cependant que se constituait dès le matin une énorme manifestation d'un million d'individus, défilant de la République à la place Denfert-Rochereau. Je dînai rapidement chez moi pour être à vingt heures dans l'immeuble de l'American Aid Foundation, juste devant l'entrée de Cochin ; c'est là que je donnais mes sous-colles d'externat, à l'instar de la plupart des autres conférenciers. J'y allai à pied suivant l'itinéraire qui allait du carrefour Vavin à l'Observatoire. Je croisai obligatoirement le boulevard Raspail que descendaient tous les manifestants. Je vis Fernand Choiseul, installé dans une ID 19, qui, de reporter sportif était devenu le reporter des manifs sur Europe #1.Il donnait un bulletin qui annonçait que les manifestants allaient occuper les Facultés du Quartier Latin. Je restai, inhibé pendant quelques minutes, à contempler sans comprendre la descente d'un carré impeccablement pythagoricien de jeunes gens des deux sexes bardés de drapeaux noirs et hurlant les slogans insurrectionnels du moment. Je pensai aux légions de Jules César quand d'autres y voyaient des phalanges nazies ou des sections trotskistes. Dans le bâtiment, toutes les salles avoisinantes étaient vides d'étudiants et de conférenciers ; seule la mienne était occupée par la moitié de mes élèves. Nous discutâmes de la manifestation et des événements pendant quelques minutes, avant de reprendre le cours régulier de mon enseignement. Je ne serais pas surpris d'apprendre que j'aie le dernier conférencier de l'histoire du concours de l'externat, et par le fait, d'avoir enterré l'externat lui-même par ce baroud d'honneur. Le lendemain la grève estudiantine était générale. Le concours de l'externat sombra définitivement dans le fracas de mai 1968. Qui d'autre que moi aurait pu s'en réjouir davantage ? La grève resta universitaire pendant quelques jours. Le mercredi après déjeuner je me rendis à Lariboisière pour donner mes cours hebdomadaires aux petites bleues. Dès mon entrée dans la cour, je fus arrêté par une délégation d'élèves conduite par le chirurgien orthopédiste Krivine et un infirmier, tous deux connus pour leurs sympathies communistes. J'appris qu'une partie des élèves de l'école venait de se déclarer en grève. Ceux à qui je devais faire cours n'acceptaient de suivre le mouvement que si j'acceptais de surseoir à mon enseignement.
J'aimais la politique, mais je n'avais jamais étudié la stratégie et la tactique politiciennes. J'avais un grand ascendant sur mes élèves, comment en douter après un tel geste de soumission ? Si j'avais décidé de faire mon cours comme je m'y apprêtais, elles auraient rempli l'amphithéâtre pour le suivre. La brutalité de ma réaction m'étonna au plus profond de mon être. Non seulement je me rallais à la grève, mais je la justifiais et je la glorifiais dans un discours improvisé qui eut un énorme impact sur un mouvement qui venait e naître spontanément mais était encore ectoplasmique. Elles ne savaient pas vraiment pourquoi elles se mettaient en grève, mes petites bleues, j'allais leur expliquer. Quelques semaines auparavant, j'avais été choqué par un article de Fred Siguier paru dans la Revue de l'Infirmière et de l'assistante Sociale que lisait régulièrement mon épouse. L'éminent interniste de Cochin, qui adorait les infirmières, jugeait de façon très pessimiste la qualité et la pertinence de l'enseignement qui leur était donné par les internes. J'avais alerté le Comité de l'Internat qui s'en fichait royalement mais me donna quitus pour leur soumettre un dossier argumenté. Je visitai une bonne douzaine d'écoles et m'entretins longuement avec leurs directrices. Je rédigeai un rapport qui fut soumis à Siguier et publié sous un forme « débarrassée de mes complexes qui n'intéressaient personne », me dit-on. Mon discours commença par le résumé de ce rapport. J'apportais des arguments techniques faciles à assimiler à une dialectique à la Danton, soutenue par mes talents d'orateurs maintenant confirmés. L'appel à la révolte ne pouvait que suivre et être suivi dans l'enthousiasme. Même la directrice était favorable à mon impulsion dont elle connaissait les racines. Je fus alors sollicité par les meneurs qui me demandèrent si j'accepterais de les suivre jusqu'à un amphithéâtre de la Pitié. Je réitérai avec la même fougue devant les délégations de toutes les écoles para-médicales avec le même succès.
Le lendemain matin, le jeudi donc, le feu s'installa aux deux hôpitaux Necker et Enfants Malades, pour une fois réunis dans un même combat. De nombreux médecins et infirmières se mirent en grève et constituèrent un comité dont le nom m'échappe. Leurs idées étaient généreuses, mais la panique régnait partout. Comme pour bien des Français, mai 68 fut un psychodrame dont on aime rarement parler à titre individuel. Je l'ai vécu intensément, passionnément, douloureusement. Il ne pouvait en être autrement car, dans la révolte des étudiants, je revivais toutes mes études de médecine et leurs frustrations castratrices. Les Professeurs de médecine, ces « mandarins » pour la plupart respectables étaient tous issus d'un système hérissé de difficultés et d'embûches, mais qui, une fois surmontées les avaient placés très tôt dans le compartiment étanche de l'élite. Ils ne connaissaient pas comme moi la misère des étudiants lambda. Les étudiants de base ne voulaient pas leur peau. En fait, ils ne risquaient rien, en tout cas physiquement, dans cet affrontement avec ces derniers, mais ils ne pouvaient pas le comprendre et encore moins admettre cette carence. Les infirmières ne voulaient pas la peau des médecins, elles voulaient leur considération et davantage de participation reconnue dans les sons du malade.. Rapidement mais pas assez vite pour éviter des comportements inquiétants, je fus envoyé au vert chez mes parents.
En septembre, je sortis de la crise meurtri, épuisé, déstructuré en partie, avec l'impression d'être une sorte de zombi. En fait, les soutiens convergents de ma femme, de ma famille, de mes amis intimes et des collègues de la salle de garde des Enfants Malades qui m'avait choisi comme économe « l'homme aux pouvoirs dictatoriaux » sauvèrent ma rentrée. Ils avaient refusé ma démission à mon retour de Bretagne et ne voulaient rien savoir de mes tourments. Le cours de ma vie repris ses droits, avec plus de poids dans la cervelle ainsi qu'une moustache éphémère. « Tu fais commun ». me dira ma grand-mère qui avait la dent dure et l'expression sèche. Ce que j'avais vécu aurait pu sinon dû mettre un terme à ma carrière hospitalière, comme cela affecta certains qui avaient été trop opportunismes et avaient choisi le mauvais camp et n'avaient pas prévu le retour de manivelle gaullo-pompidolien. Je retiens dans ma mémoire que le dernier bastion de la révolte étudiante sera l'Ecole de Médecine de la rue des Saints-Pères, nettoyée et fermée à la fin juin, et que j'ai suivi la victoire de Janssens sur van Springel dans le plus surréaliste des Tours de France jamais télévisés. En fait, une fois le recul pris sur la crise événementielle, je me sentis libéré par tous les défoulements que j'avais vécus seul ou accompagné par des étudiants, des collègues ou des inconnus rencontrés çà et là pendant deux mois. Comme une balle qui rebondit pour aller plus droit dans la cage du goal, j'allai pouvoir vivre positivement le reste de mon internat. J'avais encore six semestres devant moi pour devenir enfin « l'homo vir medicus » que mes intimes attendaient, lassés de mes hésitations permanentes sur les choix à faire et à assumer.
A RAVENSBRÜCK


LA PHARMACIE DE MARGUERITTE CHABIRON
A VERDELAIS ETAIT DANS CET IMMEUBLE

LES RESISTANTES S'ENFUIRENT PAR LE JARDIN A PIC