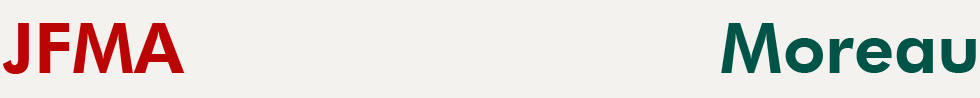Version:1.0 StartHTML:0000000260 EndHTML:0000073249 StartFragment:0000003108 EndFragment:0000073213 SourceURL:file://localhost/Users/jfma/Desktop/JFMA-CV_MEMOIRES/D%E2%80%99histoire%20de%20langues%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9loge%20du%20polyglottisme.doc
JEAN-FRANÇOIS - JFMA- MOREAU Page1 29/11/10
D'histoire de langues à l'éloge du polyglottisme.
Dr. Jean-François Moreau, AIHP (promotion 1975)
Professeur émérite, Université Paris Descartes
Electroradiologiste honoraire de l'hôpital Necker.
Juin 2010 : numéro 28 de la Lettre des Anciens de l'AP. Comment réunir dans un seul texte la série de réflexions que génèrent en moi deux moments intenses de l'année 2010 où furent évoqués les avantages et les inconvénients de s'exprimer dans la vie officielle dans une langue devenue universelle, l'anglais, que l'on parle usuellement moins bien que sa langue vernaculaire et qui, elle, ne l'est plus, le français ? D'abord, lors du dîner sur la Péniche le 11 février, la discussion qui a suivi la présentation passionnante du nouveau directeur général de l'Inserm, André Syrota, un biophysicien imageur médical à la carrière scientifique féconde au CEA, à Orsay, maintenant obsédé par les facteurs d'impact de l'Institute of Scientific Information et du classement de Shanghai. L'autre, Chantal Bismuth, née Favre, madone de la toxicologie du plus grand CHU de France, use de l'humour réaliste pour évoquer le triste destin du médecin français qui se rode à la fréquentation des congrès anglophones en se trainant à la remorque des Européens du Nord qui les infériorisent quand il s'agit, non plus de lire fluentement Cell ou le New England dans le texte, mais de jaculer (sic) son pauvre franglais devant un public aussi clairsemé qu'indifférent.
Tous nommés dans la plus prospère des décennies des Trente Glorieuses, vivent (ou survivent) intellectuellement Chantal Bismuth, AIHP, promotion 1962, Jean-François Moreau, AIHP, promotion 1965, André Syrota, AIHP, promotion 1969. Tous trois confrontés dans leur jeunesse à ce choc des cultures qui fit de l'Amérique du Nord la référence de la science médicale alors que nos facultés prônaient encore la suprémacie de la clinique française apprise grâce au concours de l'externat et sa fonction hospitalière par laquelle elle permettait d'accéder à celle d'interne dans la proportion de 1 sur 6 à Paris: la chaîne allait de René-Théophile Laennec à Fred Siguier, via Claude Bernard et Etienne-Jules Marey dont les Treize Agrégés préparaient les relais. Depuis les événements de mai 68, - tout ce qui en résulta fut loin d'être mauvais, mais là, ce fut une erreur impardonnable - il n'y a plus de leçon inaugurale pour connaître l'éclairage tutélaire des parcours hospitalo-universitaires conduisant nos maîtres puis leurs élèves au sommet des élites. Il faut féliciter Alain Laugier d'avoir eu l'idée d'archiver certains discours mémorables en leçons d'histoire de la médecine contemporaine. On peut déplorer sa sélection fondée sur l'attribution à quelques happy fews des plus grands honneurs de notre Ve République, ordres de la Légion d'honneur et du Mérite, que certains ne demanderont jamais ou n'accepteront pas de recevoir quand on les inscrira sur le tableau ; bien plus souvent encore, alors qu'ils en auraient été flattés, toute humilité gardée, ils resteront ignorés des attributeurs malgré ou à cause de leurs mérites, c'est bien connu au moins depuis Topaze.
Je suis intervenu le 11 février dernier pour me faire l'avocat du français dans la vie scientifique nationale face à un André Syrota plus que réticent. Je réagis à la lecture des textes de Laugier et de Chantal Bismuth avec la certitude que je pourrais défendre les thèses inverses des pro- et des anti-anglophonomaniaques avec la même virulence. Electroradiologiste qualifié, j'appartiens à une spécialité méprisée en pleine rénovation dans les années 60-70, le radiodiagnostic, qui se prétendait être, à la fois, la troisième discipline clinique aux côtés de la médecine et de la chirurgie, et la pionnière de la numérisation des images à l'origine d'une nouvelle recherche. Pourquoi cette ambivalence ? Comment l'assumer ?
.../...
- Pourquoi l'ambivalence ?
J'ai eu le triste privilège de prononcer l'éloge funèbre de ma plus jeune sœur décédée d'un cancer le 31 octobre dernier. Elle avait été traitée durant une décennnie dans des institutions admirables : Institut Curie, Centre médical de Forcilles, hôpital Saint-Louis, hôpital de Bligny auxquelles je veux rendre hommage car j'ai alors appris combien la cancérologie moderne impose aux personnels de toutes natures des contributions morales pénibles d'une intensité et d'une constance qui seraient insupportables s'il n'y avait eu, à la fin du siècle dernier, la révolution de la lutte anti-douleur initiée par les Anglo-Saxons ; néanmoins, l'issue fatale à plus ou moins long terme chez la majorité de leur clientèle, notamment la plus jeune, rend ces médecins et ces infirmières des proies toutes désignées au syndrôme de burn-out, à bien différencier du yuppy's syndrome.
Ma sœur naquit en durant l'été 1946 et fut enterrée le 6 novembre dernier dans le caveau familial de Challans, Vendée, un lieu où notre famille n'a plus de « relatives » depuis 1967. Mon devoir fut d'expliquer à ceux et celles qui s'y déplacèrent ce que signifie un terrroir de l'extrême occident du continent européen et son état historique au XXe siècle, séparé en deux actes par la seconde guerre mondiale, pour faire comprendre l'évolution d'une famille dont le patrimoine génétique est, pour moitié, issu d'humains qui tous vécurent sur une demi-douzaine de kilomètres carrés de marais vendéen et, pour un quart, de purs poitevins qui se mélangeront avec des messins dont l'homogénéité est moins évidente, Bismark étant passé par là.
Hors sujet ! bla-bla-bla ! remplissage ! aurait écrit à l'encre rouge, rageur, mon prof' de français ! Le texte que j'ai improvisé là-bas me fournit pourtant le joint pour donner du corps à cet article sur le polyglottisme, jusqu'alors limbique.
.../...
1946, c'est « après la guerre », la paix tricolorisée bleu-blanc-rouge sur les drapeaux français, anglais et américains toujours mélangés sur les bannières. C'est la IVe République, le renouveau de la Marseillaise et du « Liberté-Egalité-Fraternité ». Ma sœur Catherine naît, comme étaient nés ses deux frères et sa sœur, à Martigné-Ferchaud, Ille-&-Vilaine, tous délivrés du ventre maternel par notre omnipraticien de père dans le lit conjugal, « chez nous », au Vieux Pavé. Nous trois passons la saison d'été dans une petite villa de Saint-Jean-de-Monts, « Le Rêve bleu », qui a depuis disparu dans la bétonisation effreinée qui a massacré l'ambiance à la Hulot qui faisait tout le charme d'une immense plage secure. Nous sommes gardés par deux bonnes dont l'une revient d'un sana où elle traina un Pott pendant quelques années. Au bourg de Challans, nous avons vu célébrer notre tante, Marguerite-Marie Chabiron, pharmacienne à Verdelais, résistante fêtée dans l'allégresse après son retour de déportation à Ravensbrück l'année précédente dans un état qui évoquera toujours pour moi la momie de Raspar Kapak dépouillée de ses bijoux. Ma grand-mère et sa fille, qui va développer une effroyable neuropathie qui mettra vingt ans à l'achever, sont devenues communistes thoreziennes et irrédentistement germanophobissimes. Pour nous autres, le temps des Boches est loin, on mange du chocolat fouré, on mâche du chewing-gum, on achète avec des tickets, on marche sur des galoches à semelle de bois.
1944, le premier jour du printemps, naît ma sœur Dominique. C'est encore la guerre et l'Etat Français. La maison paternelle est occupée par les Allemands depuis l'été 40. A l'école primaire, j'ai appris à écrire « Travail-Famille-Patrie » sur un cahier quadrillé et à chanter « Maréchal, nous voilà ! ». Les bombardements alliés sont incessants, mon père souvent est mitraillé par les Spitfires sur les routes de campagne où il fait ses visites sur une moto Terrot quand sa Citroën 11 légère équipée d'un « gazo » refuse de fonctionner, un jour sur deux. Coco, le débonnaire chauffeur de la Kommandantur avec qui je joue depuis quatre ans, est devenu nerveux et de plus en plus distant, ce qui me peine car je n'en perçois pas la raison jusqu'à ce que mon père loue une ferme pour nous éloigner des objectifs stratégiques. Mon oncle instituteur cède à ma demande pressante : un livre de géographie dont il me rapporte l'exemplaire en couleur destiné à la préparation du Brevet élémentaire. Les planisphères montrent en rouge, bleu ou jaune, les pays où l'on parle français, anglais ou espagnol. Apprendre ces langues, c'est le prix à payer pour se sentir chez soi où que l'on se rende sur Terre, je le ferai, je le décide en ce début de juin où un événement exaltant bouleverse la famille et les voisins : l'explosion d'un dépôt d'essence bombardé par la RAF, dans la forêt de La Guerche-de-Bretagne qui flambe à quelques kilomètres de la ferme, prodrome contingent du Débarquement de Normandie qui nous fera retourner au Vieux Pavé où la Kommandantur panique et Coco disparaît. En attendant la conquête de la Planète, j'apprends à conjuguer au conditionnel passé deuxième forme et l'alphabet grec dans un vieux Larousse. Le 4 août, mon village sera libéré par l'armée américaine de Patton. I'm an American who was born in France by chance ! Un américain né Français qui a eu la chance d'apprendre chez les Frères Quatre-Bras sa langue maternelle telle qu'on l'écrivait au XIXe siècle, n'est-ce-pas, Rama Yade ?
1939, mon frère nait au milieu de l'été, quand la Troisième République s'alarme de l'invasion de la Pologne par les panzers d'Hitler. Moi aussi, ma mère me le racontera souvent, quand je prononçais « Pauvre Pologne ! » à tout bout de champ. Notre père va être mobilisé. Oncles et tantes, cousins et cousines viennent s'installer au Vieux Pavé. Un an plus tard, ce sera l'invasion des « réfugiés », tous venus « de l'Est » ou « du Nord ».
1938, 27 avril, je nais dans l'ambiance de l'Anschluss, de la crise des Sudètes, du temps où les Français étaient des cons mais ne le savaient pas encore à l'exception de Daladier. C'est encore le temps de la ligne Siegfried où la meilleure armée du monde pendra son linge après avoir pris son petit-déjeuner sur la ligne Maginot. Mon père, AEHP, vient de s'installer à Martigné-Ferchaud en « créant » une clientèle, et c'est la « dèche » catalysée par la jalousie des confères, des rappels provisoires sous les drapeaux et de pauvres moyens de locomotion où le vélo et le cheval ont leur place. Ici, on paye à terme, quand il y a trop d'entailles sur la « coche », une baguette en bois de coudrier. La philosophie est claire et nette : « C'qu'ai-à-ma-ai-à-ma ; c'qu'ai-à-ta-ai-à-ta ; c'qu'ai-à-ma-ai-pas-à-ta ; c'qu'ai-à-ta-ai-pas-à-ma ! »
.../...
1948 : les dés sont lancés, il n'y a pas de lycées et collèges hors Rennes, Nantes et Angers. Direction Lycée David d'Angers, à Angers, où une branche avunculaire huguenote est dans l'enseignement secondaire laïque, car, bien que moi alors catholique fervent, il n'est pas question de la « calotte » à Rennes ou à Combrée, ni des « jez » à Vannes ou au Mans. Les enfants de la région se divisent en trois groupes : 1) les « «classiques », qui font des études de lettres avec beaucoup de latin et du grec, l'allemand et l'anglais en première et/ou deuxième langue, ils feront un bac A-Philo ; 2) les « modernes » qui font des maths et des sciences, ils feront un bac C-Math-Elem ou Sciences Ex; 3) les « nouvelles » qui privilégient l'étude du milieu, tout en enseignant le latin et l'anglais puis l'espagnol en deuxième langue. C'est là que, toujours le plus jeune de ma classe, j'apprendrai à devenir un adolescent immature affectif en CDI, partisan du moindre effort, s'adaptant facilement à n'importe quel milieu dont je chercherai toujours à connaître les racines culturelles, nullissime en math et physique for ever, écrivant un français de bonne facture, baragouinant un anglais et un espagnol médiocres mais avec un accent de qualité grâce à l'étude approfondie de la phonétique à l'âge où s'organisent les cordes vocales dans leur boite O.R.L., sous la direction de deux professeurs géniaux, Messieurs Antier et Pierre-Morice Richard.
Je sortirai d'Angers en 1955 muni d'un bac B-Sciences-ex, probablement obtenu avec indulgence extrême du jury à la session de septembre. Je pourrai entrer en PCB à l'Université de Rennes qui me délivrera un diplôme de docteur en médecine après des avatars sans intérêt pour le sujet à traiter, sauf à louer l'extrême minceur du programme de physique médicale dispensé par un biophysicien totalement sceptique quant à l'utilité de sa discipline pour former des médecins de campagne. Seule comptait alors la qualité du parler-écrire de la langue vernaculaire : le bon français pour jouir de l'excellence de la culture nationale de l'après-guerre qui sut si bien s'approprier le jazz et la dodécaphonie, les artistes espagnols et le western, Camus et l'existentialisme, les deux Miller et Léo Ferré, Peter Cheyney et Pasternak, Aragon et Freud, sans s'abstraire de l'héritage de l'Italie de François 1er, du cubisme, des estampes japonaises et des mythes gréco-romains! Bonheur de se sentir français, une fois débarrassé du bourbier algérien ! Rêves d'utopiques évasions limités par le coût élevé des transports intercontinentaux, seulement alimentés par la cinématographie en version originale - à Angers et à Paris, pas à Rennes - et les récits de rares privilégiés qui faisaient l'Indo' ou l'AFN. J'ai appris quelque arabe dialectal lors de l'été 58 passé à la SAS de Kherba, département d'Orléansville. Achtung ! Ahmed ! ¡Déjalo! Danke schöne, Coco !
Mon frère me suivit à Angers puis à Rennes et s'exprime en anglais et en espagnol. Mes sœurs bénéficièrent de l'ouverture d'un collège à Châteaubriant qui les forma pour être, l'une, infirmière à Curie, l'autre, secrétaire de direction à Paris jusqu'à ce qu'elle épouse le fils du chirurgien castelbriantais, André Bruel, un AIHP, élève de Mondor, qui me fit faire ma première aide opératoire et me dégoûta définitivement du « bloc ». Aucune d'elles ne pourra s'exprimer dans une langue étrangère.
..../...
Avril 1965 : je suis nommé rasibus au concours de l'Internat des hôpitaux de Paris, juste avant de partir effectuer mon service militaire le 2 mai. Je termine mon semestre d'externat à Saint-Lazare, chez Jean-Jacques Bernier, un jeune turc, produit d'excellence de la réforme Debré. Il y a là des stars, consacrées ou à consacrer bientôt : Rambaud, Modigliani, Bognel, Jacotot, et un jeune interne ambitieux qui a vu son programme semestriel prestigieux ruiné par l'abandon de la libre cooptation des places jusqu'à la quatrième et dernière année. Je suis devenu « collègue », je suis donc sorti du rang par le haut et comme me l'assure Maurice Deparis pour tout compliment, « je ne mourrai jamais de faim ! ». J'écris un article avec Pierre Rigault sur les fractures du col de fémur de l'enfant, plus grosse série mondiale qui aurait dû être mon sujet de thèse si j'avais raté mon concours. Diable ! Et où cela sera-t-il publié ? Je lis Le Concours médical depuis l'âge de dix-sept ans, car c'est la bible paternelle ! Gloussements de mes collègues mi-horrifiés, mi-sardoniques. Mais je ne peux pas prétendre à La Presse médicale, rétorque-je ! Là, c'est la franche rigolade. Eux lisent le JAMA, le Lancet, j'ai oublié les autres titres, tous inconnus dans mon cercle d'amis de sous-colle! Rideau ! L'article sera publié dans le Journal français d'Orthopédie, j'ignore quel fut son impact factor !
Mai 1967 : je commence mon internat d'interniste, deviens radiologue en 1970 et publie beaucoup pour un interne, en français bien entendu, surtout des articles didactiques qui m'entraînent à oublier la facture « question d'internat ». Tous nos périodiques y passent, Le Concours médical, La Vie médicale, La Presse médicale, La Semaine des Hôpitaux...
Printemps 1971 : je bâcle une thèse de doctorat en médecine soutenue à Rennes sur un fait clinique, une tache sur mon CV dont je peine encore à avoir honte ! En effet, je paufine en même temps un mémoire d'électroradiologie sur un sujet tout neuf : les effets des artériographies sur la fonction des insuffisants rénaux dont la qualité fut reconnue par mes collègues radiologues. Il me vaudra le prix Dariaux de la Société française de radiologie et une réputation de chercheur scientifique, encore une exception dans la discipline de l'époque qui fera de moi un boursier du Fonds d'études et de recherche du Corps médical hospitalier pour trois années consécutives. Un néphrologue en jugea différemment quand mon dossier fut rejeté pour l'obtention d'une médaille d'Or que j'aurais voulu faire chez Jean Hamburger, non que le sujet fût trivial mais parce que le manuscrit était un polycopié merdique bourré de fautes de frappe et d'imprimerie ; aucun médecin ne sera ainsi honoré cette année-là. Belle leçon d'humilité qui me fera passer du dilettantisme nonchalant à la rigueur perfectionniste la plus janséniste, grâce à mon clinicat à Necker entrepris le 1er octobre 1971 chez Jean-René Michel.
.../...
1971 : le contrat moral passé avec Jean-René Michel est clair : je viens chez lui pour être nommé à « l'agreg » dans les trois ans qui suivent. J'ai 33 ans et, pour la première fois de mon existence, enfin workaholic, je vais pouvoir m'investir « à mort » dans une fonction hospitalo-universitaire plein temps dont je salue la pertinence depuis ma nomination à l'Internat. Je vais devenir un radiologue urinaire hors-pair, c'est le volet le plus facile. Je ne conçois pas la carrière HU sans un investissement majeur dans l'enseignement de sa discipline sous tous ses modes, oral, écrit, pratique, dispensés à tous les publics ; la radiologie d'après 1968 sera exemplaire, depuis l'enseignement de stagiaires jusqu'à la formation continue des praticiens ; nous sommes privilégiés et nos diapositives en dia direct font l'envie des collègues qui n'ont que leur langue pour séduire leurs élèves. Il faut participer à l'éclosion d'une recherche clinique moderne en radiologie ; j'en brûle d'envie, mais comment faire ? La lumière viendra de Michel Leski, merveilleux néphrologue dont la carrière parisienne sera brisée par son engagement dans la Gauche révolutionnaire sans avoir su préalablement assurer ses arrières. Il regrette que je n'aie pas jugé utile d'informer Jean Hamburger de mon projet, lit mon mémoire, trouve qu'il devrait être publié dans le Lancet ou le New England et m'aiderait pour cela ; il devra, hélas ! partir trop vite pour l'Université de Genève.
Les jeunes néphrologues du Palais du Rein ne pensent qu'à publier dans des revues anglo-saxonnes où ils disposent d'une aura favorable, à condition d'écrire 1) dans un anglais ou un américain « parfaits », 2) un manuscrit impeccablement imprimé sur du papier legal par des IBM à boules, 3) dont le contenu est fondé sur un matériel et une méthode irréprochables aboutissant à la démonstration de la pertinence de résultats clairement exposés à l'aide de tableaux et figures dessinés ou reproduits par des professionnels, 4) à l'origine de conclusions évidentes étayées par une discussion fondée sur une exploitation des données de la littérature excluant les auto-citations complaisantes, 5) le tout résumé dans un abstract, prédéfini par un cadre rectangulaire quand il s'agit initialement d'une communication à une société savante ou un congrès. Au sommet, Nature, au plus bas, beurk ! le JAMA. Entre les deux, une floppée de publications généralistes, fondamentales ou cliniques. Certains ne publient pratiquement pas en français, sauf dans des livres ou des bulletins et mémoires académiques. D'autres consentent à publier leurs papiers en français dans des revues de néphrologie ou de médecine interne voire La Nouvelle Presse médicale, postérieurement à la version anglaise, jamais avant. Jean Hamburger manie une langue française châtiée qui le conduira à occuper le siège numéro 4 de l'Académie française. Est-il à l'aise dans le parler anglais ? Certains - lui-même ? - prétendent qu'il ne co-recevra pas le prix Nobel en 1990 couronnant Murray et Thomas pour leur contribution à la greffe d'organes, parce qu'il a négligé de publier ses premiers travaux dans des revues américaines, ce qui ne fut pas le cas de John P. Merrill également banni. Il a créé la « Société de Néphrologie », mais n'a pas jugé bon de l'appeler « International Society of Nephrology ». Parce qu'il a accepté de lire mon manuscrit sur les néphroses osmotiques avant sa soumission à Radiology en 1974, je peux garantir qu'il avait une parfaite connaissance de l'anglais écrit qu'il savait abstraire des méprisables patois américain et australien. Les urologues de l'école de Roger Couvelaire publient beaucoup et m'associent souvent, mais en français exclusivement, principalement dans le Journal d'Urologie et de Néphrologie dont J. Cukier deviendra le rédacteur-en-chef à la retraite de son maître.
Je divise mes projets de recherche en deux parties. Financé par la bourse du Fonds d'études, l'un s'intéresse à la toxicité des produits de contraste iodés. Dieter Kleinknecht, qui m'avait initié aux mystères des néphroses osmotiques, partira trop tôt à l'hôpital de Montreuil pour être le répondant néphrologue indispensable pour affirmer le sérieux de travaux menés par un seul radiologue, même je me prétends également « interniste ». Paul Jungers jouera ce rôle mais il n'est pas anglophonomaniaque et c'est avec les histologistes Dominique Droz et Laure-Hélène Noël et l'Australien, Joseph Sabto, que j'assurerai la promotion anglophone de travaux originaux qui feront autorité durant une trentaine d'années. Très vite, l'assurance me gagne et le quadrilingue XIII Congreso Internacional de Radiología de 1973, à Madrid, accepte ma communication dans sa section « contrast media, medios de contraste, kontrastmittel, produits de contraste ». Elle est programmée le dernier matin du Congrès, un samedi, dans une petite salle où s'entasse la cinquantaine de personnes motivées par cetopic, sur lequel règne sans partage le pape de l'University of California at San Diego, Elliott Lasser. Je m'exprime pile-poil en dix minutes dans un excellent français, m'appuyant sur des diapositives sur fond bleu et en lettres blanches artistiquement superbes, en double projection simultanée bilingue, français à droite, anglais à gauche. Il n'y a pas de traduction simultanée, personne ne comprend ni ne me pose de question car le core-group est anglophone et le sujet trop néphrologique pour des radiologues qui n'en n'avaient jamais entendu parler jusque là. La publication dans Radiology est acceptée et publiée sur le champ, à temps pour être en bonne place dans « mes titres et travaux ». Qu'ai-je appris à Madrid ? Que mon espagnol est moins nul que mon franglais, qu'un congrès n'a pas d'autre intérêt pour un débutant que de faire la connaissance de collègues étrangers francophones, principalement des Belges et des Italiens dont l'amitié se manifeste encore aujourd'hui, subsidiairement de visiter une exposition technique à faire baver d'envie les traditionalistes, car la présentation du scanographe par Hounsfield est passée totalement inaperçue.
L'autre projet est gouverné par Jean-Pierre Grünfeld dont je deviens le pharmaco-angioradiologue favori car je me découvre capable de monter des catheters très fins au plus profond des veinules et des artères secondaires des reins pour des protocoles qu'il a mûri pendant son fellowship à Harvard, chez Norman K. Hollenberg. Il fait les manips aux radionuclides, je fais les injections iconographiques, au prix d'une mortalité nulle et d'une faible morbidité sans conséquences dommageables ; il rédige des articles à donner la migraine pour Science ou Kidney international, avec plein de p et de ±SEM, auxquels il m'associe en troisième position (1point Inserm) ; j'ai la fierté d'illustrer une pathologie rénale là encore quasiment inconnue du monde radiologique. Jean-René Michel prend la rédaction-en-chef du Journal de radiologie en 1965. Son premier numéro s'orne d'un article traitant de l'artériographie dans les nécroses corticales rénales que je lui fournis, expérience unique, en français et en anglais, grâce encore à Jo Sabto. Les Current Contents le citent, les demandes de tirés-à-part s'accumulent et pas seulement d'au-delà le rideau de fer. Lee Talner, de l'UCSD, en réclame un que je lui envoie avec une dédicace car j'admire ses travaux depuis que je lis régulièrement les périodiques scandinaves, américains et anglais. Puis un radiologue suédois m'envoie un de ses reprints : il s'inquiète de la possibilité qu'aurait sa molécule dimère nonionique de faible osmolatité, le métrizamide (Amipaqueâ), d'induire des néphroses osmotiques ; sur ma réponse dubitative, il m'invite à Oslo pour négocier une expérimentation clinique humaine comportant une UIV prébiopsique ; le résultat positif le décontenance quand il les lit dans la letter to the Editor que j'ai envoyée au Lancet.L'ioxaglate, le nouveau dimère ionique du Laboratoire Guerbet (Hexabrix®) comme le génial dimère nonionique de Bracco Spa, l'iopamidol (Iopamiron®), donnent également des néphroses osmotiques. J'envoie une proposition d'abstractsynthétisant ces travaux de plus en plus intriguants à Elliott Lasser, chairman d'un symposium ultrafermé sur les produits de contraste programmé en mai 1979 à Colorado Springs ; il le refuse de prime abord, puis je reçois une lettre d'acceptation de Lee Talner, chairman de la maigrelette renal session, qui n'a pas oublié l'article du Journal de radiologie ; mon voyage est payé par le Laboratoire Guerbet, mais je n'ai même pas à me défendre d'un potentiel conflit d'intérêt puisque mes travaux portent sur des produits provenant de quatre firmes européennes concurrentes ; nul ne remettra jamais en cause ma totale liberté de pensée vis-à-vis des commerciaux. J'ai écrit le texte de ma présentation de vingt minutes à l'aide d'un Harraps français-anglais en deux volumes : mes profs d'anglais avaient raison, le thème est plus important que la version.
C'est aussi l'époque ou je m'investis dans l'ultrasonographie médicale de haute définition ; The Lancet publie mon premier cas d'adénome parathyroïdien dépisté par échographie pour la première fois en Europe ; le New England publiera ma première série en 1981 ; je publierai régulièrement mes résultats en français dans la Nouvelle Presse médicale, sans négliger les Entretiens de Bichat ni Le Concours médical.
2) Comment assumer l'ambivalence ?
J'aime et chéris la langue française dans laquelle j'écris tous les jours depuis mon entrée à l'école primaire en 1943. Je déplore aujourd'hui ma tendance au gongorisme proustien qui consiste à alourdir mes phrases de plus en plus de propositions subordonnées, relatives, incidentes et autres. Je continue d'adorer le passé simple mais j'hésite dans l'emploi judicieux de la concordance des temps : « Vous me bouchiez tous les deux la vue au point que je vous suppliai de vous déplacer vers la gauche afin que vous me permettiez (permissiez ?) de jouir du panorama ; lui se pencha, vous, vous reculâtes et il s'en fallut de peu que vos pieds n'écrasèrent (n'écrasent ? n'écrasassent ?) mes orteils et qu'un coup de coude importun ne précipitât (précipita ?) mes lunettes dans la boue ! ». Le même défaut m'habite dans le parler car j'improvise mes discours sans préparation sérieuse et il se peut que mes passions ne sachent plus contrôler mon ton et mon vocabulaire non plus que le débit de ma glose.
A Colorado Springs, je fus entendu car j'avais fait des progrès en vocabulaire et en phonétique. Mon franglais enrichi amusa mes collègues. Je réussis même à glisser une joke, accessoire nécessaire mais pas suffisant pour franchir la barre ! J'en compris peu dès lors que nous étions plus de deux à échanger des propos sur des thèmes d'intérêt commun clairement identifiés. J'entrepris un voyage d'exploration de la Californie à la recherche d'un point de chute où je pourrais m'immerger pendant un trimestre entier hors de toute fréquentation franchouillarde. Je préférai pour cette raison San Diego à San Francisco. En octobre 1980, j'abandonnai femme et enfant pour un tour du monde qui commença en Australie, à un congrès où je fus invité par un confrère de Perth rencontré au ClubMed de la Réunion l'hiver précédent, et se poursuivit à Hong-Kong et à Tokyo pour s'achever à La Jolla ; pendant ce mois, je ne compris pratiquement personne hors tout contexte académique complaisant. Suivant les conseils de Laugier, j'ouvrais la télé avant de préparer mon breakfast si je n'avais pas oublié de la fermer le soir quand le jet-lag m'assommait. Good Morning America, The Jeffersons, The Price is right, The Young and the Restless, M.A.S.H., CBS Evening News..., mes chers Maîtres, merci, thank you so much ! Au bout d'un mois, je m'en aperçus le jour où je pus suivre l'élection de Reagan tout en préparant une lecture, je me mis à penser en anglais ; je fis mon premier rêve en anglais au bout de deux mois. Je n'ai pas cessé depuis d'écrire en anglais pratiquement tous les jours. Je n'ai jamais visité un endroit non francophone, notamment en Asie, sans proposer une communication ou une conférence en anglais ; un bon sujet formellement « achevé » sécurise les hôtes d'un étranger par principe à honorer des plus grandes attentions, mais non sans risques pour eux s'ils sont naïfs et bernés par un fumiste ; les successeurs en percevront le débit. Aujourd'hui, tant l'Internet que PowerPoint ont bien facilité les contacts internationaux mais combien d'emails passent-ils à la trappe quand ils sont mal rédigés ?
.../...
En 1985, nous apprenons que le « bloc asiatique » est divisé et indécis ; il devient évident que le succès de la candidature de la France à l'obtention du (supposé quadrilingue) XVIe Congrès International de Radiologie (ICR'89) passe par l'adhésion du « bloc hispanique » d'Amérique latine à notre dossier. Nous ne sommes que des outsiders peu crédibles, il faut battre l'Inde, la Thaïlande et le Royaune-Uni, tous anglophones, dans un vote par éliminations successives. En trois semaines de juin, je vais visiter dix capitales en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le Brésil jusqu'à Panamá, Los Angeles et Honolulu. Partout au sud de l'équateur, je vais prononcer une conférence en espagnol sur un thème soigneusement sélectionné, pointu mais pas hyperspécialisé, fondé sur une technologie d'imagerie cost-effective et noninvasive, accessible partout : ce sera « ecografía de la paratyroides ». On parle portugais ou espagnol en Amérique latine et très peu le français. Je rode ma conférence dans un castellano hésitant à Montevideo, l'Uruguay est le plus francophone du sous-continent, et à Asunción, domaine réservé de la General Electric, en pompant du vocabulaire sur les diapos d'un Norte-americano hispanic cardioéchographiste de Philadelphie qui passe avant moi. A Buenos Aires, le délégué argentin me dit qu'il votera pour la France, parce que 1989 c'est le bicentenario de la revolución francesa - à Paris, courageux mais pas téméraire et à ma grande fureur, on n'ose évoquer que le bicentenaire des Droits de l'homme ! - et qu'il hait les Anglais depuis l'affaire des Malouines. Le Chili est francophile et mitterrandophobe. A Lima, je fais la connaissance d'un jeune carabin francophile et americanophobe, fondateur de l'Asociación franco-peruana de los estudiantes en medicina,quémandeur d'une bibliothèque de livres français que l'Union latine financera grâce à ma rencontre avec le regretté Philippe Rossillon, l'homme du « Québec libre !», m'avouera-t-il; lui deviendra bactériologiste, sa femme radiologue, tous deux diplômés de l'Université Paris 5, grâce à des bourses partiellement financées par le Collège de médecine et des postes de FFI ; ils sont aujourd'hui le fleuron de la francophonie au Pérou. Panamá est un pays où l'on parle espagnol et anglais ; j'y obtiendrai mon plus beau succès diplomatique lorsque je choisirai l'espagnol pour m'exprimer devant l'auditoire. Quelques jours plus tard, à Honolulu, la France sera plébiscitée au premier tour de scrutin. Fait intéressant, le délégué brésilien m'apprit qu'il avait voté pour nous parce que j'avais voyagé de Panamá à L.A. sur le même vol Varig que lui ! Seules, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud avaient voté pour Birmingham par « loyauté » devant un désastre finalement annoncé et leurs délégués, que je connaissais plus ou moins, s'en excusèrent presque.
.../...
1981 : j'organise mon premier symposium « L'Ultrasonographie du cou/Ultrasonography of the neck », avec traduction simultanée de tout le programme par deux interprètes dont l'un est le meilleur de la place de Paris, ce que je confirme, et l'autre des plus médiocre ; ça pèse lourd dans le budget. 1987 : j'inaugure la nouvelle formule révolutionnaire des « Contrast media symposia », au Château d'Artigny à Montbazon ; je l'ai négociée à Honolulu en anglais avec les sept firmes internationales productrices d'opacifiants ; je me mets volontairement hors-la-loi du francophonissisme, la langue officielle est l'anglais sans traduction simultanée ; je ne suis pas traîné devant la justice. 1989 : ICR'89 trahit ma promesse, le programme ne sera pas traduit en espagnol ; seules les grandes lectures sont traduites en anglais ou en français, les deux seules langues officielles du congrès, les germaniques ayant renoncé à imposer l'allemand ; la nouvelle International Society of Radiology, présidée par Maurice Tubiana, ne s'exprimera plus qu'en anglais ; j'en deviendrai le Treasurer en 1994. 2010 : j'étonne la Sociedad de radiología y imagen veracruzolana qui m'invite à son congrès en lui apprenant qu'il y a davantage de conférenciers français hispanophones qu'elle ne le croit.
Thèse et antithèse
La plus grande des politesses que l'on puisse faire à un étranger quand on est invité chez lui à parler en français est de s'exprimer dans notre langue nationale avec pureté, simplicité et précision. Les francophones de par le monde constituent une faible minorité, mais ils sont plus fréquents qu'on ne le croit et ils parlent souvent le français mieux que nous. Le meilleur mémoire de mon équipe au plan syntaxique fut écrit par un Congolais de Brazzaville et publié dans Le Concours médicalil y a une trentaine d'années ; j'ai un jour entendu un Haïtien dont j'ai envié l'inégalable éloquence. La musicalité de notre langue depuis Malherbe et Boileau doit être un délice car les étrangers, les femmes surtout, adorent l'entendre parler. Tell me something in French ! What a beautiful language ! ai-je fréquemment entendu dire dans mes galavations autour du monde. N'hésitez pas à chanter Piaf, Aznavour et la vie en rose dans un karaoké international - on les trouve encore en Asie-Océanie - en n'occultant pas votre accent à la Maurice Chevalier... et votreimpact factor diplomatique augmentera sur le champ.
Lire, parler, écrire couramment l'anglais sans renoncer à parler sa langue vernaculaire dans la vie domestique a été l'intelligence suprême des Scandinaves et la France ne redeviendra un très grand pays que lorsqu'elle généralisera cette politique avec l'obstination d'un Jules Ferry. Refuser de s'exprimer en anglais au nom du nationalisme franchouillard le plus étroit est se tirer une balle dans l'hémisphère gauche, mais cela n'a de conséquence dommageable que pour l'individu lui-même ; et tant pis pour cet olibrius du passé s'il en souffre en discutant le prix d'un tapis à Chiraz ou d'un diamant à CapeTown à rapporter au noir. C'est plus difficile d'affronter la situation d'un agent de la France totalement à la remorque de la qualité et l'honnêté de son interprète quand il discute un contrat avec un roublard, lui anglophone et peut-être francophone sans le faire savoir. Par contre dissuader ses enfants, ses élèves, ses apprentis de devenir précocement anglophones est un crime s'il y parvient, un délit s'il n'obtient qu'une heureuse réaction antagoniste salvatrice en retour ; tout cela a la gravité de la délinquance pédophile handicapante.
Apprendre le bon oxonian english n'est pas la panacée universelle. Il n'y a pas un mais des centaines d'anglais dont le plus courant est le British heritage of the American language, fortement teinté d'old french. L'American language est une langue évoluant de minute en minute par une création incessante de mots nouveaux, ce qui mettait Jean Hamburger hors de lui, j'en ai été le témoin dans son propre bureau, un jour que nous discutions ensemble de mes progrès linguistiques au service de mes avatars internationaux. Qui n'a pas noté que les USA sont une fédération d'une cinquantaine de démocraties parlementaires qui étaient polyglottes au début du XXe siècle et le resteront à vie? Nombre de diasporas gardent le culte de leur langue ancestrale, la chinoise et l'italienne notamment, pour ne pas évoquer nos cousins acadiens et québecois. Les nouveaux mots américains scientifiques se référent principalement au latin et non au grec. In God we trust ! mais aussi United, States, America, ce qui faisait dire à Charles De Gaulle que l'américain n'est rien d'autre qu'un patois français, avec tous les pièges que ce type d'évolution sémantique produit en matière de contresens dans les parentèles ; Simone Signoret qui faisait la différence entre la réalité et l'actualité ferraillait sur le judicieux emploi d'actually. J'ai vécu pendant six mois d'internat avec un collègue francophone du Saskatchewan, sans jamais comprendre un mot de son verbiage oral alors que ses écrits étaient lisibles. Rien n'est plus réconfortant dans une discussion complexe que d'avoir un voisin aussi bilingue que vous avec qui l'on peut confronter des traductions de phrases capitales. J'adore les méditerranéens et les orientaux qui parlent l'anglais en roulant les r. Après une trentaine d'années d'immersion en anglophonie, je me targue de parler le morenglish. « They're amazed by your English, but they understand you ! » Pourquoi ? Parce que j'ai appris la phonétique à l'âge de dix ans ! Je suis un promoteur de l'idée d'enseigner la phonétique en continu durant tout le primaire ; tous les nourrissons de la prime enfance pratiquent tous les phonèmes, notamment les nasales qu'ils élimineront de leur prononciation en fonction du milieu idiomatique dans lequel ils vont grandir à partir de la seconde enfance. S'il est encore possible d'apprendre le japonais ou un mandarin compréhensibles quand on est un adolescent à la voix musicale, inutile d'espérer devenir expert en cantonais si on n'a pas été immergé dès la prime enfance dans la Chine méridionale au sud de Shanghai.
Parler anglais, WallStreet English ou autre, ne vous rend pas nécessairement populaire quand vous voyagez dans des pays non francophones volontiers américanophobes. Hablar Ingles o/or Spanish speaking ? That might be the question.Les USA sont envahis par des Latinosen proie à des tendances souvent contradictoires qui dissocient un profond désir d'être naturalisés américains quand ils ne le sont pas déjà et celui de garder leur spécificité quand ils le sont ; ils peuvent être vexés si vous leur parlez en espagnol au risque de ne pas vous comprendre si vous utilisez votre anglais. A plus ou moins long terme, la langue américaine en sera profondément marquée. Le spanglisha plus d'avenir que le frenglishet sera peut-être le noyau d'un nouveau globish, salué qu'il sera par tous les indo-européens sinon les asiatiques comme l'espéranto du IIIe Millénaire. Il engendrerait de toute façon d'innombrables patois à devenir dialectes plus ou moins officiels en quelques décennies.
.../...
Une chose est certaine : parler ces trois langues européennes, français, anglais, espagnol, est bien le sésame que je pressentais en 1944 ; j'ai pu m'exprimer en espagnol en Australie, en anglais au Brésil. Est-ce suffisant ? 1990 : je suis invité à rejoindre un groupe d'uroradiologues européens pour enseigner en anglais nos collègues d'Europe de l'Est délivrés des Soviets. Ni à Gdansk, ni à Budapest, ni à Prague, ni à Sofia, nos nouveaux amis ne parlent ni ne comprennent l'anglais, le français pas davantage d'ailleurs, sauf et encore à Bucarest ! Ils parlent allemand ou russe ! Vingt ans plus tard, ils se sont adaptés quand ils n'ont pas émigré en Amérique du Nord ou en Australasie. L'anglais devient la langue de communication européenne et les editors-in-chief des European Journals sont des British academics.
.../...
Merci, cher André Syrota, de pousser les jeunes étudiants masterisables à publier en anglais dans Nature, Science, Cells, les PNAS... Leurs impact factors respectifs sont liés à l'extrême difficulté d'être admis dans leurs colonnes. L'excellence est un précarré étroit et prétendre y entrer est un noble but, à condition de s'en donner les moyens et de s'attendre à d'incommensurables désillusions, surtout si on s'exprime dans un frenglish aisément détectable par n'importe quel referee jaloux de vos résultats mirobolants en provenance d'un pays, la France, par définition suspecte de laxisme congénital. La route de la soie vers Shanghai est du domaine de la globalisation mondialisée et c'est par dizaines de millions que les jeunes de la Planète s'y engagent... où refusent de s'engager ! Vous n'êtes pas sans savoir que la recherche médicale nord-américaine n'est plus signée en premier par des Yankees mais par des Li, des Lee, des Chen, des Yamamoto, des Ng, des Ravanangra, des Abdessalam, des Coulibali, des Moratuvu... auxquels se mèlent parfois des Martin, des Schmidt, des Svoboda... Un editor-in-chief passe 95 pour cent de son temps à rejeter des articles. Il arrive que un rédacteur d'article appartienne à une école étrangère réputée pour son sérieux durable. C'est un plusque l'on aura cultivé, chère DameChantal, pendant des années de participations actives à des congrès un peu partout dans le monde, lesquelles seront suivies de visiting lecturerships répétés, lesquelles généreront des invitations à des exclusive symposia, en attendant la consécration suprême du visiting professorship... Anecdote significative : novembre 1980 : je suis à Boston, arrivé impromptu au MGH pour un brain storming à quatre qui s'achève plus tôt que prévu, le matin de la veille du Thanksgiving Day ; j'appelle Norman K. Hollenberg pour lui demander qu'il accepterait de me recevoir en début d'après-midi pour que je lui soumette un problème de pharmacodynamique atypique que j'étudie avec des injections de dopamine-furosemide dans l'artère rénale de transplantés rénaux avec Henri Kreis. Il ne me connaît pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais que je peux me recommander de Jean-Pierre Grünfeld. « Jean-Pierre ? Yes ! Please come now ! ». Il me reçoit très aimablement, plié en deux par une sciatique qu'il n'est pas difficile de relier à une hernie discale aiguë qui l'empêche de s'asseoir. Nous parlons ensemble une bonne demi-heure et il regrette que je doive quitter Boston le jour-même pour San Diego, avant que nous ne puissions fixer un rendez-vous confortable pour que je puisse faire une vraie lecture sur mon sujet qui le passionne ; je ne le publierai que sous forme de lettre à l'éditeur de la Nouvelle Presse médicale, après l'avoir présenté oralement et avec succès à la Society of Uroradiology.
Merci, Dame Chantal, pour votre paragraphe humoristique que je me garderai bien de satyriser. C'est le rôle d'un patron/patronne que de guider ses élèves dans des congrès à la recherche de fils d'Ariane ténus mais quasiment insécables quand ils réunissent des individus de bonne volonté. J'ai eu la chance de pouvoir le faire pour la plupart de mes élèves et cela a conforté ma popularité dans certains milieux internationaux qui me donnent encore des signes d'amicale fidélité. Les Français sont affublés, moins aujourd'hui qu'hier mais encore plus que demain, d'une réputation de légèreté et d'inconstance que seule peut démentir la confrontation des francosceptics avec de vrais Français citoyens du monde ouverts à l'anglophonie. « You don't have to denigrate your patry ! » me dit un jour un collègue texan quand je me plaignais de notre propension au conservatisme et de ne pouvoir assouvir mon libéralisme « américanoïde » en France.
Beg your pardon, dearAndré Syrota ! Sauf à créer une presse scientifique à l'origine de English Journals of French Medicine, Biology, Nuclear medicine..., ce qui n'est pas pour demain, faute de referees bilingues en nombre et en qualité suffisantes, et je le regrette, il est de notre devoir, nous qui dirigeons (ou avons dirigé) des équipes françaises de recherche de valeurs inégales parce que faites d'individus de valeurs inégales, de favoriser la publication de leurs travaux respectifs dans des revues francophones qui leur assureront la pérennité de leurs cogitations au meilleur du coût/efficacité, c'est-à-dire la satisfaction métaphysique du devoir accompli. Je ne connais personne qui n'ait frissonné de plaisir en voyant son nom imprimé dans la liste des auteurs d'une première publication, d'émotion à la première prise de parole en public. Combien de fois n'ai-je vu des jeunes gens déboussolés parce qu'on leur avait confié des travaux dépassant leur capacités intellectuelles, l'inverse étant d'ailleurs également observable ? Ils n'iront pas jusqu'au bout de leurs publications dans les revues du top de l'anglophonie, un monde où il ne leur sera promis au mieux qu'une publication dans une revue de troisième choix à très faible impact factor, dont tous les gens sérieux rigoleront à supposer qu'ils les lisent. Déçus, ils ne feront pas de pub en faveur de l'investissement dans un PhD de cinq années auprès de leurs cadets.
Impact factor quand tu nous tiens ! La communauté scientifique européenne ne lui devient sensible qu'au début des années 90, du moins en radiologie, avant même nos collègues américains pour l'évolution de leur carrière. 1974 : sur ma suggestion parce que j'ai été bien briefé par les néphrologues, Jean-René Michel obtient la couverture du Journal de radiologiepar les Current Contents. C'est important pour la diffusion des titres des articles publiés dans une littérature universelle sélectionnée par ISI, The Institute for Scientific Information, nous l'avons vu plus haut. 1988 : à Boucicaut, mon collaborateur Mourad Souissi étudie avec Michel Ebelin de « SOS-main », les premiers au monde sur de grosses séries, la nouvelle imagerie par ultrasons et résonance magnétique des muscles et tendons de la main; il ne pratique pas l'anglais, je n'ai pas le temps de traduire ses articles ; nous confions les trois premiers au Journal de radiologie, nous ne recevons aucune demande de tirés-à-part ! Le quatrième sur l'IRM ira à la Presse médicale, avec un succès moins confidentiel. 1991 : je prends la rédaction en chef d'un Journal de radiologie moribond ; contrairement à ce qu'exprime déloyalement la première de couverture, il a perdu la couverture d'ISI il y a quelques années, comme d'innombrables revues cliniques non anglophones ! Mon équipe s'est fait avoir, tant pis ! Par contre, je n'admets pas ce fait accompli et j'entreprends une enquête auprès d'ISI en me rendant à son bureau à Philadelphie pour en connaître les raisons et surtout voir comment on peut les pallier ; je parviendrai à mes fins au bout de deux ans de loyaux efforts ; You're known in the United States, me fais-je entendre dire, tant il est important d'être l'ami de ses amis quand on veut s'en faire reconnaître par le biais de l'estime ; un américanophobe avéré n'a aucune chance de passer la barre pour entrer dans le Upper room ; après il pourra dire librement ce qu'il pense à condition de ne pas user de statementsmais d'evidences. Dès 1994, tous les auteurs du Journal seront indexés dans les Current Contents/Clinical Practice, avec un facteur d'impact certes faible, mais dont la croissance espérée sera le résultat des efforts des auteurs francophones pour améliorer leur articles. J'offris là un beau cadeau à la francophonie et aux orgueilleuses Editions Masson qui s'empressèrent de vendre le journal... à la Société Française de Radiologie et à Elsevier.
Il existe en France une longue tradition d'éditions médicales, didactiques et scientifiques nationales, diffusées encore largement dans la francophonie européenne et africaine. Dans la société mercantile qui nous dirige, elle maintient une richesse économique à la fois financière et intellectuelle qu'il n'y aucune raison d'assècher dans son douar d'origine sous peine de s'appauvrir. Mieux vaut un bon article en français que rien en anglais virtuel et rappelons que Mendel s'exprima en tchèque pour colliger sa découverte de la génétique à partir de son potager qui mit trente ans à être connue grâce à un traducteur bilingue dont je n'ai jamais vu citer le nom. Il appartient aux Universités françaises de mieux mettre en valeur les travaux produits par leurs chercheurs, même et y compris en français, surtout si on vise Shanghai. Médecine/Sciences pour ne citer que cette revue mérite mieux que le mépris.
Il ne fallait pas perdre la Guerre de Sept Ans qui consacra le suprémacie naissante de l'anglais dans le monde diplomatique en plein XVIIIe siècle des Lumières. Ami Syrota, blâmez Jeanne d'Arc d'avoir choisi le clan des Armagnac, vainqueurs à la Pyrrhus d'une guerre de Cent Ans qui empêcha l'Angleterre de définitivement parler le françois et/ou fit que la France ne parlera pas l'anglois.
Nous vivons dans un monde universel anglophone où le français a sa place et où le vrai vainqueur est l'humain polyglotte à l'aise dans au moins trois langues pour aller partout où l'on sera ravi de l'accueillir, même avec un passeport français si l'on y va sans morgue ni arrogance.
A RAVENSBRÜCK


LA PHARMACIE DE MARGUERITTE CHABIRON
A VERDELAIS ETAIT DANS CET IMMEUBLE

LES RESISTANTES S'ENFUIRENT PAR LE JARDIN A PIC