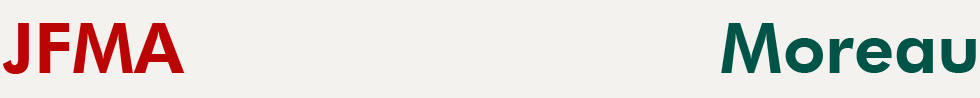Ce texte présente deux médecins dits AEHP, c'est-à-dire anciens externes des hôpitaux de Paris:
mon père, le Dr Jean-Paul Moreau, médecin omnipraticien à Martigné-Ferchaud (Ille-&-Vilaine - 35167) 
et moi, Dr Jean-François Moreau,
tous deux bien différents et pourtant les mêmes que mon grand-père, le Dr André Moreau, médecin omnipraticien au Perreux-sur Marne (autrefois dans le département de la Seine, maintenant dans le 94) et mon arrière-grand-père, le Médecin Général JAB Mathieu
et mon arrière-grand-père, le Médecin Général JAB Mathieu
Il a été rédigé à l'attention du Docteur Jacques Paulin, historiographe de l'Externat des Hôpitaux de Paris.
Il a été rédigé à l'attention du Docteur Jacques Paulin, historiographe de l'Externat des Hôpitaux de Paris.
Par mon père, je descends d'une lignée de médecins de père en fils sur quatre générations. Mon arrière grand-père, le Médecin-Général Jean-Baptiste-Edouard Mathieu était chirurgien militaire. Je connais son histoire glorieuse grâce à une copie du discours nécrologique prononcé lors de ses obsèques et par quelques pages léguées par sa fille benjamine. Elle se déroula depuis Louis-Philippe jusqu'à la IIIe République sur de nombreux champs de bataille, dont la guerre de Crimée, la guerre d'indépendance de l'Italie, la bataille de Reischoffen, la Commune de Paris... et dans de nombreux pays, dont l'Algérie, l'Italie, le Vatican et la Tunisie dont il organisa le service de santé. Il termina sa carrière en tant que directeur de l'école de médecine du Val-de-Grâce et mourut en 1915, après avoir été décoré de la Légion d'honneur au rang de commandeur et de l'ordre du Nickam Nifticar. Son fils aîné, Charles Mathieu, également médecin général mais issu de l'école de la santé navale de Bordeaux, est à l'origine de deux générations de médecins, dont le docteur Antoine Roux, installé à Cenon en Gironde, qui fut mon parrain et a récemment décédé. Sa fille aînée, Marie-Marguerite Mathieu, épousa mon grand-père, le docteur André Moreau, un omnipraticien d'origine poitevine monté à Paris qui s'installa au Perreux-sur-Marne, alors incluse dans le département de la Seine, maintenant dans le 94 (Val-de-Marne) ; l'un de ses oncles était officier de santé à Tiffauges. Son frère cadet, François Mathieu, ingénieur de l'aéro-navale, épousa la fille d'un médecin, le docteur Lorrain, qui, bien qu'ancien interne des hôpitaux de Paris à titre provisoire, n'exerça jamais son métier mais me légua quelques livres de médecine et d'anatomie.
Le docteur Jean-Paul Moreau, AEHP, (1910-1978)
Bien que mon père racontait volontiers son enfance et son adolescence à ses enfants, il commit l'erreur de ne pas écrire lui-même l'histoire de sa vie. Il faut donc que je fasse appel à ma mémoire, infidèle et tronquée, pour évoquer le cursus de ses études médicales qu'il effectua intégralement à la faculté de médecine de Paris. Il était né en 1910 et il semble que la forte personnalité de son père le porta d'autant plus tôt vers la médecine qu'il avait une clientèle florissante et jouissait de la considération des habitants de cette ville de banlieue bourgeoise.
Le docteur André Moreau était un homme élégant, ancien épéiste au corps d'athlète, d'une grande distinction et portant beau. Point important que mon père partagea avec lui, il était un buveur d'eau intégral, particularité rare dans la France ouvrière et rurale, y compris chez les médecins, souvent sollicités de voire un petit coup avec les malades reconnaissants pour leurs soins, ce qui en conduisit certains à un alcoolisme quasiment professionnel. Mon grand-père pratiquait la médecine clinique de l'époque dans son intégralité sans transiger sur la rigueur ni la qualité ; il respectait intégralement et strictement les règles hippocratiques. Il vécut un premier drame en perdant tôt son premier enfant, une fillette atteinte de méningite tuberculeuse. Il fut, que je sache, mobilisé pendant les quatre années de la première guerre mondiale, mais il en parla très peu à ses petits-enfants. Homme catholique qu'on dirait aujourd'hui intégriste, de droite maurrassienne, sans doute pétainiste, il dut à la protection de mon père de ne pas être inquiété à la Libération. Je garde un souvenir précis des dix dernières années de sa vie. En 1942, il maria sa fille benjamine à un médecin lillois, le docteur Xavier Carton, ancien externe des hôpitaux de Paris, qui, après avoir été médecin dans les mines du Nord de la France, se spécialisa en dermatologie qu'il pratiqua à Amiens ; médecin des hôpitaux, chef du service de l'hôpital universitaire, il ne passa pas l'agrégation mais il fut un président actif et estimé du Syndicat national des dermatologistes. Mon grand-père exerça jusqu'à sa mort brutale, probablement par rupture d'anévrysme abdominal, un matin qu'il se levait pour aller visiter un malade. Il y eut beaucoup de monde à ses obsèques en 1953.
Comme la plupart des médecins de l'époque, mon père fit des études secondaires classiques dans des « boîtes à curés » de Paris. L'impression qu'il laissa à ses enfants fut celle d'un collégien lymphatique, peu amoureux de l'école, mais certainement assez doué et cultivé pour passer son bac philo sans difficulté ni mention... après que son père l'eut menacé de l'expédier comme pensionnaire chez les jésuites de Poitiers. Son intérêt pour la vie s'éveilla dès son inscription à la faculté de médecine pour entreprendre ses études de médecine avec passion. Il avait la « vocation » qui, dit le philosophe, est le choix des autres, mais il semble qu'il ne subit aucune pression directe de l'un et l'autre de ses parents pour faire ce choix. Il n'aurait rien su ni pu faire d'autre. S'il aima la biologie, il n'avait pas de dons pour les sciences exactes, mais il n'eut pas de difficultés à valider l'année du PCN. Toujours résident chez ses parents et tôt levé, il prenait le train pour la gare de la Bastille chaque matin pour aller à ses stages hospitaliers et à la faculté de la rue des Saints-Pères. Il prépara le concours de l'externat des hôpitaux de Paris. Fut-il nommé à son premier concours ? Je ne sais plus, je n'en suis pas certain. Toujours est-il qu'il se sentait suffisamment bien préparé pour affirmer à son père, alors qu'il allait prendre son train le matin du concours, « j'aurai 50 ». Il fut effectivement reçu avec cette note, je ne sais à quel rang. Je pense que c'était en 1930 ou 31.
Mon père n'eut aucune difficulté à être un externe zélé, rapidement compétent. Il porta avec dévotion la blouse, le tablier et le calot que les habilleuses lui sélectionnaient pour qu'il soit toujours impeccablement vêtu. Je ne connais pas la totalité des semestres qu'il effectua dans les hôpitaux de l'Assistance publique à Paris durant, je crois, quatre ans. Il fut externe chez Vaud, chirurgien pédiatre de l'hôpital des Enfants assistés ; il y donna les anesthésies générales au masque d'Ombredanne « sans avoir un accès direct au visage du patient » ; il y fit sa thèse de doctorat en médecine sur le « Pieds valgus congénital convexe ». Il passa un an chez Laignel-Lavastine, neuropsychiatre de l'hospice de la Salpêtrière, grand ami de son père. Mais le patron dont il parla toujours avec amour, ce fut Gandi, médecin des hôpitaux, chef de service à Lariboisière. Ce fut son vrai maître. Il le décrivait comme un homme à la fois compétent et modeste, très attentif à ses malades qu'il vouvoyait, prévenant vis-à-vis de son personnel tout en gardant ses distances. Un jour, Gandi prit ses vacances « en lui confiant son service » ; ce fut le plus beau jour de sa vie d'externe.
Pourquoi ne prépara-t-il pas le concours de l'internat ? L'externat semble avoir été son bâton de maréchal, mais il y a quelques explications à cette apparente carence d'ambition titrée. D'abord le titre d'AEHP était un privilège qui classait les étudiants en médecine à un rang supérieur chez les omnipraticiens et mon père, plus porté vers la médecine que la chirurgie, n'était pas intéressé par une spécialisation d'organe alors peu développée. Asthmatique, il était physiquement moins robuste que son père et souffrait probablement des transports véhiculaires quotidiens. Intrinsèquement indépendant et libéral, il voulait s'émanciper de la puissance paternelle avec qui il n'avait jamais envisagé de s'associer. Monarchiste mais patriote, il ne chercha pas à éviter le service militaire qu'il ne voulut pas faire comme simple infirmier ; il s'astreignit, chaque dimanche pendant deux ans, à la préparation militaire supérieure et, malgré une mauvaise performance physique, réussit à valider une formation qui lui permettrait d'être sous-officier. A la fin de ses études de médecine, mon père traversa une crise morale qui le faisait douter de lui. Il passa sa thèse et résilia son sursit. Il fut affecté comme médecin-adjudant à l'hôpital militaire de Sarrebourg en 1935 ou 36. Il y rencontra sa future épouse, Marie-Magdeleine Chabiron, une challandaise, infirmière militaire dans son service occupé principalement par des soldats de bataillons d'Afrique du Nord. Ils se marièrent en 1936 ou 7, à Paris, dans la plus stricte intimité.
Démobilisée, ma mère vivait à Paris chez son amie d'enfance, Antoinette Cordier, la femme d'un jeune chirurgien des hôpitaux prometteur, Gaston Cordier, qui finira ses jours comme, chirurgien de la Pitié, titulaire de chaire d'anatomie et Doyen de la faculté de médecine de Paris. Le ménage était désargenté, mon père ne pouvait acheter une clientèle, a fortiori épouser la fille d'un médecin. Il devait créer une clientèle à partir de rien ; le chirurgien de Rennes, Abel Pellé, AIHP, élève de Delbet et ami de Cordier, signala la possibilité de créer un poste de médecin dans un bourg d'Ille-et-Vilaine, Martigné-Ferchaud. Il y avait deux médecins âgés qui prendraient bientôt leur retraite. L'un avait une fille à marier, ce qui arrivera avec un jeune médecin quelques années plus tard, mais les filles de l'autre étaient des célibataires endurcies. Mes parents avaient visité d'autres endroits sans attraits assez forts pour s'opposer à la séduction d'une installation dans un bourg d'apparence prospère construit sur le flanc nord escarpé d'un étang de barrage de la rivière du Semnon. Arrivés au volant d'une Amilcar ou d'une Peugeot 201, je ne me souviens plus, par la route de Vitré à Chateaubriant, ils découvrirent un lieu majestueux dominé qu'il est par une église qui a tout d'une cathédrale.
Ils s'installèrent dans une maison bourgeoise sur le haut du plateau, Le Vieux Pavé, qu'ils louèrent à vieux grigou de propriétaire qui ne leur fit pas de cadeau. Sur la facade nord, au rez-de-chaussée, devant une pelouse, un perron permettait d'accéder, à gauche, à la salle d'attente, à droite, au bureau paternel. Les pièces professionnelles étaient bien séparées des appartements privés. Il y avait le téléphone et l'électricité mais pas d'eau courante ni de tout-à-l'égoût. A l'entrée de la maison, une plaque professionnelle en cuivre présentait le docteur Jean Moreau, avec, sur une ligne au dessous, en majuscules d'imprimerie «ANCIEN EXTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS » Ses deux confrères y virent une déclaration de guerre de la part d'un jeune confrère prétentieux qui prenait 20 francs par consultation et faisait péniblement ses visites sur une petite 201. La correspondance de ma mère avec sa famille démontre l'extrême dureté de leur condition durant leurs premières années de vie de médecin de campagne dans un bled situé au confins de trois départements, Mayenne, Maine-et-Loire et Loire-Inférieure dont ils étaient déparés par une ceinture de forêts. L'année 1937 fut spécialement austère tant rares furent les clients. En avril 1938, je naquis à leur grand bonheur mais dans le bruit de l'Anschluss et mon père fut remobilisé pendant trois semaines sur le front de l'Est.
Mon frère naquit en août 1939, alors que la clientèle commençait à devenir consistante, juste avant la déclaration de la guerre contre l'Allemagne liée à l'invasion de la Pologne. Mon père fut mobilisé à la Régulation Routière n°5 avec le grade de sous-lieutenant. Il fit une guerre assez combative pour gagner la croix de guerre, mais la déroute de juin 40 le déporta vers Toulouse où il fut démobilisé aux alentours du 18 juin. Avec deux de ses amis à qui il restera fidèle toute sa vie, il débattit de continuer la guerre en Angleterre, ce que fit l'un d'eux, en rupture de ménage. Mais, comme beaucoup, démoralisé par l'attaque de Mers-el-kébir, il décida de regagner sa famille et sa clientèle, sans doute la décision la plus sage mais aussi déprimante. En effet, s'il eut le bonheur de retrouver ses enfants grandis et sa femme vaillante, une partie de la maison était occupée par les sous-officiers allemands, fort corrects au demeurant ; nos champs alentour étaient devenus des parcs à chars d'assaut et camions militaires camouflés sous les grands arbres. Il avait perdu sa clientèle et on l'avait oublié dans la réservation de bons d'essence. Il acheta une bicyclette à un curé belge qui fuyait vers la Haute-Bretagne, un engin pesant avec des freins dans le moyeu qu'il équipa de deux sacoches en cuir où il stockait son matériel d'urgence. Dans ce canton où côtes et mauvaises routes étaient balayées par des vents pluvieux, mon père devait pédaler en ahanant. Fort heureusement, son asthme avait disparu avec le bon air campagnard, mais les paysans locaux hésitaient à l'appeler de peur de le fatiguer, ce qui achevait de le démoraliser.
La situation s'améliora avec le départ à la retraite de l'un des médecins dont il récupéra la clientèle après qu'il l'eut guéri avec du Tænifuge Ercé d'un ver solitaire mal autosoigné par des semences de courge. Il eut des relations confraternellement amicales avec le jeune médecin qui avait épousé la fille de l'autre au milieu de la guerre. Surtout, sa réputation de médecin compétent et dévoué s'affirmait au point qu'il put acheter d'abord une moto Terrot puis une Citroën 11 légère qu'il fit équiper d'un gazogène. Mon père était un excellent clinicien qui toute sa vie ausculta à la serviette. Fin diagnosticien, il était aussi un excellent thérapeute, talent reconnu notamment par les pharmaciens avec qui il entretint toujours d'excellentes relations. Contrairement à ce qui est trop souvent galvaudé par les médecins parisiens devenus scientifiques après la guerre, la thérapeutique jouait un rôle important, notamment pour éviter les complications graves de maladies infectieuses alors endémiques, notamment la tuberculose, la scarlatine, le croup et les salmonelloses. Il préférait la médecine à la chirurgie et à l'obstétrique, mais il était adroit et assistait constamment les chirurgiens quand il fallait opérer. Il fut toujours apprécié des femmes et des enfants. Il devint médecin de la SNCF et de la gendarmerie.
Que je sache, mon père n'appartint pas à un réseau de résistance, pas plus qu'il ne collabora activement avec les Allemands ; ses rapports avec l'occupant restèrent dans l'épure médicale éthique de l'époque. La situation évolua dangereusement à partir de l'année 1943 et surtout durant le premier semestre 1944. Les bombardements alliés étaient fréquents et les chasseurs-bombardiers de la RAF mitraillaient tout ce qui se véhiculait sur les chemins et les routes, notamment les rares automobiles. Il renonça rapidement à la croix rouge sur fond blanc qu'il avait installée sur le toit de la Citroën et qui affinait les tirs des aviateurs. Son frère cadet, André-Jacques Moreau, échappé de Berlin où il avait été réquisitionné par le STO, s'était réfugié au Vieux Pavé. Dans les mois qui précédèrent le débarquement allié, il s'installait sur le toit de la voiture avec une paire de jumelles et tapait un coup violent dès qu'il observait des avions de chasse ; mon père arrêtait la voiture et ils se jetaient dans les fossés. Pour cause de maladie mortelle qui avait emporté son beau-père, mon père véhicula sa famille en Vendée. C'était alors les bombardements intensifs du 6 juin sur toute la région nantaise. Nous échappâmes de peu à la bombe qui pulvérisa un passage à niveau du côté de Nozay.
Le 4 août 1944, dans l'après-midi, après trois jours de défilé permanent de l'armée allemande de Rommel en retraite, ce fut la libération de Martigné-Ferchaud par l'armée Patton et la fin d'un cauchemar qui avait duré quatre ans. Ce même jour, mon père accouchait ma mère de leur première fille, comme il accoucha les trois autres, dans la chambre parentale. Il fut mobilisé une nouvelle fois mais pour peu de temps avec le grade de capitaine. Dès l'année 1945, il était devenu « le » médecin d'un vaste territoire d'une quinzaine de kilomètres de rayon qu'il parcourait vêtu de pantalons et de bottes de cheval, une tenue dont on se souvient encore maintenant. Le prestige de mon père faisait rayonner ses enfants depuis peu scolarisés. Mon père nous emmenait souvent mon frère et moi faire sa tournée quand elle se déroulait en voiture, avec tous les aléas que cela signifiait en matière de crevaisons et de pannes de carburation. Ma vocation médicale commença très tôt et « je voulais faire les consultations pendant que mon père ferait les visites ». J'ai appris avec lui comment on se comporte devant les menaçants chiens de ferme, on examine un malade, on fait bouillir la seringue en verre, on décline le verre de « goutte », on abrège une conversation trop longue...
Ma mère tenait la comptabilité et là, mon père fit étalage d'une grande insouciance quant au règlement des factures de ses clients. Contrairement à ses confrères, il ne parvint pas à faire payer cash consultations et visites et les mauvaises habitudes se prirent vite. Dans certains cas, les « poulets de la reconnaissance » palliaient l'impécuniosité des paysans miséreux ; dans de trop nombreux autres, il y avait des arriérés de deux ou trois années qui justifiaient parfois le recours douloureux à l'huissier. Le manage vécut dans l'aisance, mais au prix d'un travail harassant, sans jamais prendre de vraies vacances. On comptait sur les doigts des deux mains le nombre annuel de nuits durant lesquelles mon père n'était pas appelé en urgence au moins une fois. On accouchait alors à la maison, les accidents étaient fréquents et le médecin était appelé après l'échec des manipulations du rebouteux. Il y en avait de célèbres dans la région dont mon père s'accommodait dès lors qu'ils ou elles ne pratiquaient pas des injections ou des traitements agressifs. Il était réputé pour son excellent caractère, son urbanité sans « fierté » ni familiarités, ses colères exceptionnelles mais tonnantes. J'en ai souvenir d'une mémorable lorsqu'un jeune inspecteur des impôts voulut le taxer d'office pour dichotomie automatique. S'il y a une chose que mon père n'aurait pu pratiquer, c'est bien cet acte vénal moralement ignominieux. Le préposé n'insista pas.
Mon père n'eut jamais la tentation de s'engager politiquement. Il laissa ma mère devenir conseillère municipale en 1945, puis adjointe au maire pendant une vingtaine d'années. Par contre, il eut une activité soutenue au sein du Syndicat départemental des médecins puis au Conseil de l'Ordre d'Ille-et-Vilaine. Il fut un ardent propagandiste des enseignements post-universitaires lancés à Rennes dans les années 60. Il lisait exhaustivement « Le Concours médical » avec délectation et juste après, Ridendo et la « La vie du Rail ». L'apparition après la guerre de la sécurité sociale ouvrière qui précéda celle de la sécurité sociale agricole vers 1960, fut un élément-clé de la meilleure santé financière du médecin de campagne, mon père compris bien qu'il batailla constamment contre les atteintes au régime purement libéral pour lequel il était fait. J'ai le souvenir de ses combats syndicaux pour la revalorisation des lettres-clé C et V et contre le projet Gazier. Il accueillit avec joie le désir des femmes rurales d'accoucher dans les cliniques qui s'ouvrirent dans les sous-préfectures, notamment à Châteaubriant avec qui il travailla beaucoup. Seule entorse à la vie de relation, il adhéra au Rotary-Club, avec quelques Martignolais dont Emile Bridel qui était un de nos amis intimes et fut à l'origine de l'expansion économique du canton de Retiers quand il développa la Laiterie-Beurrerie-Fromagerie qui porte son nom jusqu'à ce qu'il la vende à plus gros que lui..
Vinrent la soixantaine et le début du déclin de sa santé. Il avait mal préparé sa retraite qu'il appréhendait. Ses enfants s'étaient émancipés et vivaient dans la région parisienne. Il vendit sa clientèle à un de ses remplaçants et mes parents s'installèrent à Versailles en 1976. Je lui diagnostiquai un cancer métastique d'origine sans doute pancréatique, au printemps de 1977 au-dessus de toute possibilité thérapeutique. Ma mère débuta un cancer suraigu dès après la naissance de son deuxième petit-fils en janvier 1978. Elle décéda six semaines avant mon père et tous deux furent enterrés dans le caveau familial du cimetière de Challans, Vendée au début de l'été 1978.
Mon père expira dans mes bras. Il me dit avant son dernier souffle une phrase tragique, mais réconfortante pour qui pouvait douter légitimement de la justice de son sort : « J'ai vécu la vie que je voulais, avec la femme que je voulais, en exerçant le métier que je voulais ! ». Puis-je en dire autant ?
Docteur Jean-François Moreau, AEHP, AIHP.
Ma vocation médicale est-elle le choix des autres ? De mes parents d'abord ? Ma relation avec mon père fut fusionnelle et le couple qu'il forma avec ma mère fut mon idéal familial. Comme je l'ai déjà dit, mon père m'associa à sa vie professionnelle, dès son retour de la guerre de 39-40. Enfant trop précoce, j'ai longtemps traîné une immaturité affective qui m'a évité de céder à un choix alterne pourtant tentant « licence-journalisme-politique » que m'interdirent mes parents quand j'eus seize ans et un bac B. Je n'avais pas été élevé à la dure et la majorité légale était à l'âge de 21 ans. Incapable d'imposer une volonté à mes parents qui tenaient le cordon de la bourse, je passai un bac Sciences Ex et m'inscrivis en PCB à la faculté des sciences de Rennes puis à la faculté de médecine de Rennes. J'exhibais une nullité crasse en sciences fondamentales et c'est par un sort spécialement douteux quoiqu'heureux que j'ai réussi à passer mes examens toujours sur le fil du rasoir. Je le payerai cher quand je me frotterai aux concours hospitaliers rennais.
J'avais une très haute opinion de la médecine et pour comprendre la difficulté d'être le fils du Dr Jean-Paul Moreau, AEHP, je n'ai jamais réussi à le coller sur des questions d'actualités médicales des plus récentes. La vie d'un étudiant en médecine ne commençait pour moi qu'avec la réussite du concours de l'externat. Celui de Rennes me fut fatal, car j'échouai, toujours rasibus, à trois reprises et une quatrième chance me fut refusée au nom d'un règlement absurde alors que je menais des sous-colles avec des succès constants. En cinquième année de médecine, j'avais à peine 23 ans et je n'avais devant moi que la perspective d'un stage interné, le passage d'une thèse et la résiliation de mon sursit alors que la guerre d'Algérie n'était pas encore terminée. Pourquoi m'étais-je braqué sur le concours de Rennes au lieu de monter à Paris comme nombre de bretons? D'une part, parce que la formation clinique médicale de base y était excellente, bien meilleure qu'à Paris pour qui ne pensait qu'à la médecine omnipraticienne ; d'autre part, parce que l'externat de Paris était un monstre aux allures freudiennes que je ne parvenais pas à terrasser.
Je proposai à deux externes rennaises de mes amies de monter à Paris préparer avec moi le concours de l'externat, car on ne pouvait se spécialiser qu'en ophtalmologie à la fac' de Rennes. L'une voulait devenir pédiatre, l'autre, anesthésiste-réanimatrice. Moi, je ne savais qu'une chose, je ne voulais pas être un médecin de seconde zone, un médecin raté qui ne savait rien, rien de rien. Nous nous sommes inscrits à la conférence de médecine de Jean Boralevi et à celle de chirurgie de Jean Cohen. Nous avons travaillé intelligemment et nous avons été reçus tous les trois, plus un autre Rennais qui nous avait rejoints pour sous-coller. J'ai été reçu 22ème, rendant ainsi à mon père une joie intense alors qu'il avait aussi mal vécu que moi les échecs qui nous avaient confinés dans ce que je pensais être un « déshonneur ».
Ce n'est pas évident de commencer un externat en 6eme année de médecine quand on n'a pas de projet défini. Pédiatre ? Je choisis un poste d'externe dans le service chirurgie infantile de Marcel Fèvre, aux Enfants-Malades, où je resterai un an. J'y rencontrai ma future femme dès ma première garde ; elle était une belle et brillante infirmière, l'Œdipe collait bien et je l'épouserai en 1964, alors que j'étais externe en pédiatrie médicale chez Marcel Aussannaire, à Saint-Vincent-de-Paul. A Rennes, la neurochirurgien avait un grand prestige, j'effectuai le semestre d'été 1963 chez Marcel David à la Pitié ; j'y fus heureux mais définitivement la chirurgie en salle d'op' stérile me déplaisait et la neurologie, ma première vocation médicale, n'offrait aucun avenir à un externe. J'obtins un semestre d'hiver 1963-4 chez Maurice Deparis, médecin interniste réputé de Bicêtre, qui me confirma le bonheur que j'éprouvais à soigner les gens âgés. Mon dernier semestre s'effectua chez Jean-Jacques Bernier, à l'hôpital Saint-Lazare, dans l'optique alors définitive de valider une spécialité de gastro-entérologie à mon retour de service militaire. Je devais en effet partir pour la 1er S.I.M. de Vincennes le 2 mai 1965.
Un matin de fin de nuit agitée, alors que je n'avais pas encore les résultats du concours de l'externat, je sortis d'un rêve avec une voix féminine qui me susurrait : « Tu seras Interne des Hôpitaux de Paris ! ». Rétrospectivement, après de longues méditations sur cette prédiction des plus improbable, j'ai été amené à penser que ma muse devait être Antoinette Cordier, ma marraine, qui était venue à mon baptême avec Gaston à l'automne 1938. IHP ? Et puis quoi encore ?! Je m'inscrivis à la rentrée de 1962 à deux conférences de préparation à l'internat. Malgré les encouragements de Marcel Guivarc'h, chirurgien tonique, j'abandonnai au bout de quelques semaines, je ne parvenais pas à me concentrer sur des questions. Fiancé et moralement soutenu par ma future femme, bien installé dans la médecine parisienne après un an quasiment sabbatique, je m'inscrivis de nouveau à une préparation sérieuse à l'internat. Je dois à Jean-Paul Clot, chirurgien brillant et excellent pédagogue d'avoir démystifié le programme de chirurgie. J'étudiai la médecine dans les Pérelman et Margairaz qui, après avoir enchanté les candidats à l'externat, avaient publié leur exceptionnel dossier de préparation à l'internat, voire du Bureau central des médecins des hôpitaux. Je travaillai intelligemment, c'est-à-dire que j'allais tous les matins à l'hôpital, je potassais mes questions en les réécrivant comme si j'étais assis dans la salle de la rue de l'abbé de l'Epée, chaque après-midi dimanche compris, je me couchais de bonne heure quand je n'avais pas conférence, je sortais ma fiancée puis ma femme chaque samedi pour voir un film.
J'étais certain d'être reçu à l'écrit. Je fus en effet admissible à l'oral. J'eus la meilleure de mes notes en médecine sur la crise d'asthme de l'adulte, une question facile, mais piégeuse, que je rédigeai à partir d'une observation de malade que j'avais suivi attentivement chez Deparis. En anatomie, toujours friand de la région du cou, j'eus la moyenne sur le nerf facial extra-crânien parce que je connaissais bien la parotide ; de même en chirurgie où je tombai sur tuberculose rénale, question qu'avait posée mon maître Denys Pellerin que je savais féru d'urologie et que Jacques Cukier, jeune adjoint de Couvelaire, nous avait fait sous-coller. Je réussis, malgré une médiocre préparation, à me tirer de l'épineuse session de physiologie, pour la dernière fois en six questions de dix minutes. Car ce concours était un concours de liquidation. Le programme de l'internat changerait l'année suivante avec un gros programme de physiologie à traiter en question d'une heure. Les externes qui passaient leur quatrième ou cinquième concours seraient nommés en priorité, c'était le bruit qui courait avant de commencer l'oral en janvier 1965.
L'oral de l'Internat était le cauchemar de tous les candidats. Je n'avais eu que quelques semaines pour le préparer avec mes amis Philippe et Marie-Charles Raux, connus chez Deparis. Jean-Paul Clot nous prépara magistralement à cette épreuve terrifiante en nous faisant parler devant un « jury » fictif, dans le très bel amphithéâtre du défunt hôpital Broca. Au bout d'un mois, je parlais avec une éloquence inattendue chez un grand timide comme moi. La composition du jury du concours 1964 stupéfia le monde médical car il n'y avait pas de représentants des grandes écoles patronales, les chaires et leurs élèves nommés principalement par Robert Debré et Pasteur-Valléry-Radot. Peu nombreux étaient les externes qui avaient un patron direct dans le jury. J'en avais deux, le neurochirurgien Bernard Pertuiset « qui se souvenait de moi !», le chirurgien Jean Bienaymé, adjoint de Marcel Fèvre qui connaissait ma réputation de médecin sérieux et avec qui ma femme travaillait tous les jours dans l'antenne de chirurgie néonatale. Il y avait même Jean Rey, le pédiatre alors plus jeune agrégé de France qui était un ami intime de ma femme et appréciait mes qualités.
L'on sait qu'à l'époque, l'oral se déroulait dans l'amphithéâtre tout neuf du Pavillon de la Clinique Médicale Infantile Robert Debré des Enfants-Malades. Je fus tiré dans le premier tiers, ce qui limitait d'autant mon temps de préparation pour digérer un programme que je ne maîtrisais qu'en partie. Le douze premières turnes planchèrent sur des questions « bateaux » qui m'auraient plu. Je fus tiré à la treizième et ce fut pénible. D'abord, je me retrouvais en compagnie de Philippe Raux et d'un poulain de Jean Rey. Or, il n'y avait que deux candidats par turnes à qui l'on donnait le point fixé à 22/30 ou plus. Je marinai pendant deux heures, entendant notamment Philippe Raux dont la voix surpuissante perforait les murs sans que, pour autant, on puisse identifier les questions sur lesquelles il planchait. J'étais l'antépénultième et blémit lorsque je découvris l'intitulé des questions. Horreur ! il y avait « plaie du cœur », question que j'abhorrais, et « cancer du pancréas », une question que j'aurais dû débiter sans souci puisque j'en observais couramment chez Bernier. Or, je voyais le début et la fin de la question, mais pas le milieu. Quant à plaie du cœur, j'avais pris le mauvais plan, celui de Schlogel au lieu de celui de Clot. Je fis donc deux merdes et je voyais pâlir la face de mes deux patrons exilés au bout de la table à ma droite et celle de Rey non moins exilé à gauche froncer des sourcils à chaque erreurs que je proférais. Sans patrons, j'étais foutu car Raux ne pouvait pas ne pas avoir plus du point - le jury avait déclaré qu'il nommerait l'homme cette année-là, la femme l'année suivante et l'élève de Rey avait été bien meilleur que moi. Toutefois, je parlai bien, sans notes et en dix minutes chrono. La délibération fut très longue. Raux avait 25 et moi 22, grâce à la défonce de Bienaymé soutenu par Pertuiset qui voulaient me nommer sur ma valeur et non pas sur des combines que ce médiocre jury avait mis sur pied. Rey était furieux car j'avais dit une énorme connerie qui aurait dû à elle seule m'éliminer. Pertuiset me tança d'un « Vous êtes content ? ». Bienaymé qui est un homme charmant me fit entendre que je l'avais fait souffrir mais, il le raconta à ma femme le lendemain, il avait fait un grand numéro dont il était ravi.
J'avais obtenu le point, mais pour être nommé, il fallait que mon écrit fut meilleur que celui des autres concurrents du bas du tableau. Il y avait en principe 220 places, mais le point ne fut pas coupé et je terminai la liste en position d'avant-dernier : 234eme. J'étais furieux de la médiocrité de ma performance, mais on me fit comprendre que ce qui était important, c'était d'être nommé. L'orthopédiste Pierre Rigault, adjoint de Jean Judet, avec lequel je venais de publier un article sur les fractures du col du fémur de l'enfant et qui, très traditionaliste, m'accueillait toujours par un « Bonjour, Monsieur l'Externe », me reçut à ma première visite suivant les résultats : « Alors, ça y est, tu es collègue ! maintenant on peut se tutoyer ! ». Jean-Jacques Bernier qui m'avait ignoré jusques là, se montra expansif et me félicita chaudement tout en m'offrant une place de chef de clinique en 1972 ! Maurice Deparis me regarda avec scepticisme tout en assurant « qu'au moins vous ne mourrerez pas de faim ! » et que « j'étais fou » quand je lui parlai de mon intérêt pour la gériatrie au point de me spécialiser dans ce champ que je pressentais plein d'avenir. Daniel Alagille me reçut avec empressement à sa demande, car j'avais épousé sa meilleure infirmière ; je lui fit part de ma déception d'avoir été reçu avant-dernier ; il minimisa totalement cette conter-performance car j'avais été reçu à mon premier concours et cela valait son prix , ce en quoi il se trompera puisque mai 68 détruisit l'ordre établi sur la réservation directe des places, un système devenu ingérable.
Bien entendu, ma nomination à l'internat rendit à mon père toute sa superbe. Je l'accompagnai à un EPU et fis bon emploi dans la discussion sur le rhumatisme articulaire aigu, une de mes questions favorites. Mon maître de l'hôpital Pontchaillou, Jean-Joseph Sambron, AIHP, qui fut le seul à avoir fait quelque chose pour moi quand j'étais dans le marasme à Rennes, m'accueillit tout rayonnant par un « Mon vieux Jean, tu leur as montré ce que tu valais ! ». Je mesurai alors combien mon père avait dû souffrir de mes échecs qui retombaient sur sa fierté d'avoir un fils médecin objet de mépris. Jean-Joseph Gastard, son adjoint, me regarda avec une certaine admiration « reçu au premier concours ! » me faisant une sorte de révérence amusante. Enfin, quiconque a connu les « classes » à Vincennes et le peloton d'EOR à Libourne, sait l'importance d'avoir été reçu à l'internat pour l'avancement, titre qui équivaut à la possession de 6IV (inscriptions validées) .
Il faut maintenant conclure.
Je n'hésite pas à dire que ma vie d'externe des hôpitaux fut la période la plus heureuse de ma vie médicale. Jamais je n'ai été aussi proche de mes malades, jamais je n'ai eu autant de plaisir à étudier que celui que m'a procuré la préparation tardive, mais décomplexée, du concours de l'internat. J'ai été partisan de la disparition du concours de l'externat car je crois qu'il n'est pas possible d'être un bon médecin si on n'est pas formé tôt à l'hôpital avec des fonctions rémunérées. J'ai regretté la désinvolture de nombreux étudiants vis-à-vis de leur présence au lit du malade comme j'ai déploré le laxisme de nombreux patrons et chefs de clinique à leur égard.
Mai 68 a vu la fin de l'externat en tant que concours. J'étais alors conférencier de préparation à ce concours dont la formule devenait obsolète. J'ai quelque raison de penser avoir été le fossoyeur des conférences d'externat. Le 13 mai 1968, vers 20 heures, en effet, je me rendais à pied à la Maison des Etudiants en face de l'hôpital Cochin, dont je louais une salle pour accueillir un vingtaine d'étudiants de PCEM désireux d'apprendre la sémiologie médicale. Je marchais le long du boulevard Montparnasse puis du boulevard de Port-Royal, Je croisai les files interminables de manifestants qui descendaient depuis la place Denfert-Rochereau pour occuper la Sorbonne et la Faculté de Médecine des Saints-Pères, dite alors « Nouvelle Fac' ». Je retrouvai la moitié de mes étudiants prêts à travailler, les autres étaient partis faire la révolution. Toutes les autres salles étaient vides. A la fin de la conférence, je fis un tour à la Sorbonne où se déchaînait l'excellent orchestre des Haricots Rouges dont on a perdu lamémoire. Le concours d'externat sinon la fonction disparut durant le mois de juin sous Edgar Faure.
Interne, puis chef de clinique, jeune agrégé puis patron, je me suis impliqué profondément dans la formation socratique des externes. Plus tard, j'ai eu la joie de voir mes jeunes collaborateurs prendre le relais avec enthousiasme quand le patron d'un trop gros service doit dégager les responsabilités par le haut. J'ai été à deux reprises, en 1976 et en 1996, membre du jury de concours de l'internat. Je ne reconnais plus les externes d'aujourd'hui dans la mesure où le style littéraire de leurs écrits s'est appauvrit jusqu'à parfois frôler l'illétrisme. Souvent hospitalisé dans le cadre de maladies de longue durée, je constate avec regret la perte du sens clinique que cultivait l'apprentissage-bachotage de la sémiologie.
P'tit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antant !
A RAVENSBRÜCK


LA PHARMACIE DE MARGUERITTE CHABIRON
A VERDELAIS ETAIT DANS CET IMMEUBLE

LES RESISTANTES S'ENFUIRENT PAR LE JARDIN A PIC