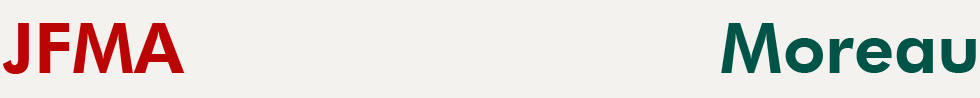Cher BB,
4.3. MOREAU EN AMÉRIQUE, PREMIÈRE (MAI 1979)
Sportif de compétition, non-fumeur depuis la mort de mon père, heureux dans mes recherches, je pouvais affronter l'Amérique et accessoirement le monde entier. J'en mourrais d'envie depuis longtemps. Pour le moment, j'en mourais plutôt de peur. D'une part, je n'arrivais pas à écrire ma conférence pour Colorado Springs et n'avais réussi à faire que des diapositives à base de tableaux sur lesquels j'étais incapable d'improviser en anglais. D'autre part, il y avait une sérieuse grève des transports aériens intérieurs américains et mon agent de voyage ne parvenait pas à me faire aller plus loin que les grandes villes de la côte Est. J'allais même jusqu'à envisager de prendre un train transcontinental qui mettait trois jours à relier New York à Denver. Louer une voiture n'aurait pas davantage de succès. Vint le moment où même cette solution était dépassée. Alors qu'il ne me restait plus qu'à annuler mon voyage, grâce à l'agence de voyage de Guerbet, je pus bénéficier d'un billet de première classe pour Miami, sur la défunte compagnie « National Airlines ». Je mis toute ma documentation et mon «Harraps » en deux volumes dans ma Samsonite blindée et pris le taxi pour Orly Sud. Deux déceptions m'attendaient. Des hôtesses hors d'âge et d'une laideur affligeante servaient une nourriture indigne du standard annoncé.
La correspondance à Miami était trop courte pour que je puisse sortir « en ville » et trop longue pour que je n'explore pas l'aéroport de fond en comble. Je dus admettre que je ne comprenais pas un traître mot d'américain, spécialement quand il sortait des hauts parleurs. La gentillesse par contre était partout, y compris à l'interminable contrôle de police. Je me rendis à Denver en fin d'après-midi sur un vol « Continental », d'une bien meilleure facture, dans un avion tout neuf. Assis contre un hublot, je ne quittai pas des yeux le paysage du Sud-Est américain avec ses énormes fleuves sinueux, se jetant dans une côte marécageuse. Le jet volait très haut et courait après un gros soleil polychrome rasant qui ne se couchait jamais ; nous volions dans le sens de la rotation de la terre, à l'inverse de Phileas Fogg. L'hôtesse me proposa un cocktail, ce qui me plongea dans l'embarras car je n'en buvais jamais ; je n'avais pas de drink favori, à l'inverse de tout mâle américain. Me souvenant de mes séries noires, je commandai un « Manhattan », le seul nom qui me vint à l'esprit. Ce fut au tour de l'hôtesse d'être perplexe. Ce cocktail était complètement démodé ; elle en demanda la formule exacte à mon obligeant voisin, un Américain qui vivait à Tahiti et parlait impeccablement le français non ! ce n'était pas Marlon Brando ! Ma valise avait été enregistrée à Orly et transitait sans moi, imprudence que je ne commettrai plus jamais. Il m'aida à la récupérer à Denver et me laissa ses coordonnées au cas où je serais dans l'embarras le lendemain. Avec une certaine surprise, je le vis rejoindre un groupe de vrais loubards.
J'étais supposé avoir une chambre réservée au « Hilton Downtown ». Il était très tard. La réceptionniste n'était pas au courant. Elle n'était pas de Miami, mais son accent différent était tout aussi abscons à mes oreilles. Devant mon désarroi, elle finit par me trouver une chambre minuscule qui tenait du sous-marin. Le nombre de verrous à la porte me plongea devant un abîme de réflexion. Je pris le hurlement d'une ambulance pour celui d'une voiture de police. Violente Amérique ! Jet-lag aidant, je finis par m'endormir pour une courte nuit. Après m'être fait livrer un American breakfast dans ma chambre, je m'attaquai à la rédaction de ma conférence. Tout s'était débloqué dans ma tête, je pus laisser libre cours à mon frenglish. Vers midi, je fis une pause pour aller me aller me promener à pied. Les parcs étaient beaux en ce milieu de printemps et le musée historique intéressant et émouvant quand il évoquait l'époque d'avant Napoléon 1er et la possession française de la Grande Prairie sur les deux rives du Mississipi. En bon Français, j'avais laissé ma clef à la réception en quittant l'hôtel. À mon retour, il me fallut au moins une demi-heure pour prouver le bien-fondé de ma requête et je compris qu'en Amérique, l'on garde sa clé durant tout son séjour. Je terminai ma rédaction tard dans la nuit. J'étais content de moi, j'avais inclu une plaisanterie en son milieu. Très important, m'avait-on dit à Necker. À la télévision, je ne compris qu'une partie des grandes lignes du journal diffusé sur CBS.
4.3.1. COLORADO SPRINGS
Le lendemain, je retrouvai les trois autres Français du symposium - Jean Lautrou, Mme Eloy de Lyon et un autre dont j'ai oublié le nom - à l'aéroport pour rejoindre Colorado Springs en petit bimoteur à hélices, assis sur un siège minuscule et raide. Le relief des Rocheuses était impressionnant comme un mur géant au bout de trois mille kilomètres de plaines. J'avais lu « Colorado Saga », le pavé de Michener. Le symposium avait lieu dans un des plus beaux palaces des Etats-Unis, le « Broadmoor », gigantesque monument centenaire de style italo-germano-américain de l'avant-Frank Lloyd Wright. Tout autour, il y avait des golfs et des piscines, avec des gardiens en charge d'expulser tous les amateurs dès que les orages se déclenchaient, et il y en avait d'assez tumultueux et luminescents. La foudre tuait surtout les imprudents, comme on nous l'apprenait à l'école des Frères.
Le Symposium commençait à 2p.m. Je parlais vers 4. Cela valait mieux dans un sens. Lee Talner m'avait gentiment accueilli. Ancien de Yale, il s'exprimait avec une belle voix grave et lente, comme on l'apprend dans cette université privée de Hartford, Connecticut. Son principe oratoire se résumait en une seule équation « one minute, one slide » et non pas « diap » comme je m'évertuais à le dire, alors que nul ne savait ce qu'était une diapositive. Je me retrouvais au lycée. Nous nous promenâmes pendant une bonne heure. Ses questions étaient inquisitrices, mais bienveillantes. Je commençai ma conférence comme dans un rêve, sans chercher à brider mon accent français. Je sentais qu'on me comprenait dans les grandes lignes et que mon sujet plaisait. Ma plaisanterie à base d'escargots de Bourgogne et de Brigitte Bardot n'avait rien de spirituel, mais elle déclencha des rires sonores de sympathie. J'obtins un succès bien supérieur à ce que nous attendions tous, moi compris. Je me dépatouillai comme je pus des questions qu'on me posa surtout par politesse. Un orateur redoute toujours les questions, mais se désole quand son discours n'en inspire pas. À la sortie, un éminent néphrologue anglais me salua d'un « good paper », un grand Américain hilare, svelte et concave en avant, me tapota affectueusement en répétant plusieurs fois « he made a joke, eh, eh, eh... ». Sur le plan scientifique, c'était gagné et j'avais obtenu un crédit ouvert sur l'acceptation de mon character, mon personnage plutôt que ma personnalité et certainement pas mon caractère.
Le Symposium était bon pour les Américains, mauvais pour un Français. La recherche aux USA n'avait rien produit d'intéressant depuis vingt ans. Toutes les nouveautés provenaient d'Europe Occidentale, principalement de la Norvège, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Ils n'avaient aucune expérience clinique des nouvelles molécules. Il y avait deux clans, ceux qui voulaient entendre parler de mes autres travaux et les autres. Le symposium était un peu truandé, ce qui n'était pas mon problème en lui-même. Néanmoins, pour la première et la dernière fois de ma vie, je fus prié par un chairman de me taire, par une phrase du genre, « la question ne sera pas posée » d'un président de tribunal célèbre. Quand je voulus faire état de l'absence totale de douleur au cours des injections intraartérielles d'Hexabrix, j'eus le temps de prononcer quelques mots qui seront censurés dans la relation des minutes de la discussion enregistrée sur bandes magnétiques et fidèlement rapportées par ailleurs. Je mettrai plusieurs années pour connaître les raisons de ce politiquement incorrect alors ésotérique.
Le succès de ma conférence m'avait débloqué et Lee Talner s'était proposé de la traduire en bon anglais sans trahir un seul mot de mon sabir. J'étais couramment largué, mais moins par la compréhension de la langue que par la technicité des propos. J'avais ma place dans une conversation dès lors qu'il n'y avait pas plus de trois à quatre interlocuteurs. La plupart des intervenants étaient des vedettes mondialement connues. Ils étaient d'une grande simplicité et, dès lors qu'on leur était sympathique, d'une grande cordialité, comme le diaboliquement gigantesque Australien Geoffrey Benness qui parlait un anglais d'un autre monde. Beaucoup d'entre eux avaient amené leurs femmes, très excitées par la beauté et le confort de l'hôtel. Phyllis, l'épouse d'Elliott Lasser, jouait le rôle de la femme typiquement Américaine avec ses lunettes papillon et sa francophobie affichée. Elle me fit passer sur le gril pendant une heure interminable, assis que nous étions sur des transats au bord de la piscine. Elle voulait tout savoir de moi à partir de questions convenues et de réflexions surannées, jusqu'à ce que je lui montre une photo de ma femme épanouie tenant notre fils dans ses bras, qu'elle soupçonna immédiatement d'être très ancienne. Je lui confiai mon intention d'aller visiter Lee Talner à San Diego, durant mon dernier week-end aux USA. Elle me conseilla en partie par vacherie, mais aussi par respect, parce qu'elle n'avait pas réussi à me déstabiliser, de descendre au «Sea Lodge Hotel», le plus luxueux palace de la Jolla.
Un après-midi, je potassais le Guide Bleu dans un fauteuil du salon pour organiser mon voyage d'une semaine en Californie, tout en buvant une pinte de Coors, bière locale pourvoyeuse de fonds du républicain Gerald Ford, successeur de Nixon empêché, m'apprit plus tard Lee Talner. Quatre jeunes radiologues américains, de loin les plus sympathiques du groupe, me virent et m'invitèrent à boire un Jack Daniel's dans une de leurs chambres. Ils me firent parler assez longtemps et me demandèrent de leur exposer mes projets immédiats. Ils consistaient en une visite touristique à San Francisco et à Sacramento où je connaissais un urologue cajun de naissance et à San Diego, avant d'embarquer à Los Angeles dans le vol direct d'Air France pour Paris. L'un d'eux, Robert Brasch, l'un des benjamins du panel d'orateurs, me demanda de le prévenir lorsque je serais à San Francisco pour me guider dans une cité beaucoup plus vaste que je n'imaginais. Le plus âgé, John Amberg, l'homme hilare du premier jour, restait pensif et silencieux en me scrutant d'un regard soutenu. Les autres habitaient des villes que je n'étais pas censé visiter. Le plus difficile fut de leur expliquer que je voulais acheter du matériel d'archerie dans l'une de ces villes. Ma prospection à Denver n'avait donné aucun autre résultat que la panique du chauffeur de taxi ; il m'avait conduit dans un faubourg particulièrement lépreux et dangereux de la lointaine banlieue, pour ne pas trouver la boutique signalée dans les « Yellow Pages » ; par contre on avait croisé des motards chevauchant, comme dans Easy Rider et les films de Clint Eastwood, des Harley-Davidson à franges, des malabars bedonnants aux cheveux longs, tatoués et portant des insignes nazis sur des vêtements de cuir débraillés. Bien que j'eusse acheté mon matériel dans la boutique « New Archery » de la porte de Châtillon, ils ne parvenaient pas à cerner de quel sport je voulais parler. Joignant le geste à la parole, je pris la pose de l'archer immortalisée par Bourdelle ; alors l'inspiration jaillit d'un des cerveaux sidérés « Aho ! yes ! you mean bow and arrow ! », un sport de boy-scout, totalement incompatible avec le standard académique des médecins présents dans la chambre, plutôt portés sur le golf.
Vint la fin du symposium et le temps des adieux jamais spectaculaires aux Etats-Unis. Je quittai le Broadmoor avec Jean Lautrou pour l'aéroport dans un « yellow cab » brinqueballant conduit par une jeune fille blonde sans originalité typiquement Middle West germano-scandinave en quête d'argent de poche. Soudain, John Amberg fit irruption dans le taxi et s'assit sur le strapontin en face de nous. Ainsi j'avais toujours l'intention d'aller à San Diego. Je serais stupide de descendre au Sea Lodge dont les chambres coûtaient au moins deux cents dollars de l'époque Carter la nuitée. Je devais descendre chez lui. Il était seul avec les plus jeunes de ses dix enfants. Sa femme était partie dans le Minnesota d'où ils étaient originaires. Il avait une grande maison à La Jolla, le Saint-Tropez de San Diego, et plusieurs chambres étaient vides de pensionnaires. Je pense avoir alors réagi comme un Français. Je lui rétorquai que j'étais très sensible à son invitation qui m'honorait, mais non, vraiment ! je ne saurais l'importuner « I don't want to break your feet » lui dis-je tout fier de mon pluriel. « No ! you don't want to be a pain in my neck ! » aurais-je dû dire, finit-on par m'apprendre poliment la tournure argotique sera pour plus tard « I don't wanna be a pain in your ass ! ». Il insistait tellement que je finis par l'assurer que je lui téléphonerais ma décision finale une fois arrivé à San Francisco.
A RAVENSBRÜCK


LA PHARMACIE DE MARGUERITTE CHABIRON
A VERDELAIS ETAIT DANS CET IMMEUBLE

LES RESISTANTES S'ENFUIRENT PAR LE JARDIN A PIC